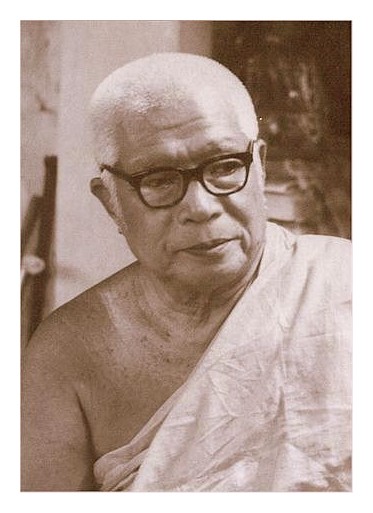
| Le Dhamma de la Forêt |
Manuel
pour l’Humanité
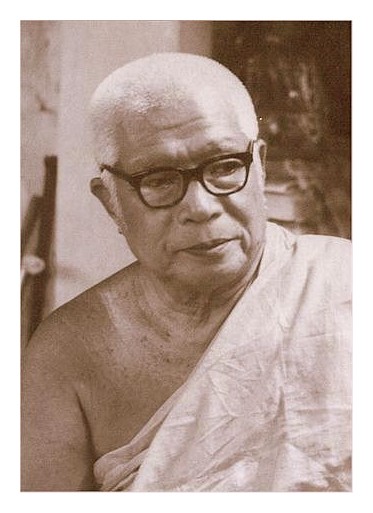
Buddhadasa Bhikkhu
Traduction
de Jeanne Schut
Titre original : A Handbook for
Mankind, 1964
INTRODUCTION
En 1956, le vénérable Buddhadasa a donné un cours sur le bouddhisme à un groupe de personnes qui allaient devenir juges. Ces conférences, données en langue thaïe, ont été enregistrées puis transcrites et structurées pour finir par former ce qui est devenu un Manuel pour l’Humanité.
Depuis lors, le succès remporté par ce petit livre a été stupéfiant et il continue à être très populaire, tant en Thaïlande qu’en Occident. La raison en est que le vénérable Buddhadasa offre ici un regard neuf sur une vérité qui ne connaît pas les limites du temps (le Dhamma) dans le style direct et simple qui caractérisait son enseignement. La clarté de sa vision pénétrante donne vie au Dhamma de sorte qu’aujourd’hui encore, une nouvelle génération de lecteurs peut ressentir tout le sens et toute la valeur de ses paroles.
Ce livre est un guide inestimable pour tout nouveau venu au Bouddha-Dhamma, la vérité à laquelle s’est éveillé le Bouddha et qu’il a enseignée ensuite car il contient l’essentiel des enseignements du bouddhisme. Le « manuel » est tout particulièrement utile à ceux qui s’intéressent aux enseignements du Bouddha non comme à un thème d’étude mais comme un moyen de comprendre leur vie et de lui donner toute sa noblesse.
Nous remercions Mr Pun Chongprasoed qui a été le premier à mettre ce livre en forme en thaï et tous ceux qui ont ensuite permis qu’il soit reproduit et traduit en de nombreuses langues.
Pour
plus d’informations, contacter : Dhammadana Foundation
c/o Suan
Mokh Chaiya Surat Thani 84110 Thailand.
Chapitre I
REGARDS SUR LE BOUDDHISME
Les auteurs modernes s’accordent à reconnaître que toutes les religions du monde sont nées de la peur. Autrefois les hommes craignaient le tonnerre, les éclairs, l’obscurité et autres phénomènes qu’ils étaient incapables de comprendre ou de maîtriser. Pour en éviter le danger, ils faisaient preuve d’humilité ou de soumission ou rendaient hommage à ces manifestations et les vénéraient. Plus tard, lorsque la connaissance et la compréhension de l’homme se développèrent, cette peur des forces de la nature se transforma en une peur plus difficile à appréhender. Les religions basées sur la vénération des phénomènes naturels, des esprits et des êtres célestes en vinrent à être ridiculisées, tandis que la peur se faisait plus subtile : une peur de la souffrance, de cette souffrance qu’aucun moyen matériel ne peut soulager. L’homme se mit à craindre la souffrance inhérente à la naissance, à la vieillesse, à la maladie et à la mort, ainsi que la déception et le désespoir engendrés par le désir, la colère et l’ignorance – toutes choses qu’aucun pouvoir, aucune richesse ne peut soulager.
Il y a quelque deux mille ans, en Inde, d’intelligents penseurs et chercheurs cessèrent de rendre hommage aux êtres surnaturels et choisirent de rechercher plutôt les moyens de conquérir la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, ainsi que les moyens de supprimer la convoitise, la haine et l’ignorance. De ces recherches est né le bouddhisme, méthode pratique découverte par le Bouddha pour éliminer la souffrance et venir ainsi définitivement à bout des peurs de l’homme.
Le mot « bouddhisme » signifie « l’enseignement de celui qui est éveillé ». Un Bouddha est un être « éveillé », qui connaît la vérité de toute chose, qui connaît précisément la véritable nature des choses et peut ainsi se comporter de manière appropriée en toutes circonstances. Le bouddhisme est une religion basée sur l’intelligence, la science et la connaissance. Son but est d’éliminer la souffrance ainsi que les causes de la souffrance. Tous les hommages rendus à des objets sacrés sous forme de rites et de rituels, d’offrandes ou de prières, n’ont rien à voir avec le bouddhisme. Le Bouddha a rejeté les êtres célestes, alors considérés par certaines sectes comme les créateurs de toutes choses, ainsi que les divinités dont on pensait qu’elles résidaient dans les étoiles. On rapporte, en effet, que le Bouddha a déclaré : « Le savoir, l’habileté et les capacités engendrent le succès et ont des conséquences bénéfiques ; ils sont bons en eux-mêmes, indépendamment du mouvement des corps célestes. Grâce aux mérites acquis par ces qualités, un individu pourra largement dépasser les insensés qui se contentent de s’asseoir en faisant leurs calculs astrologiques ». Et aussi : « Si l’eau des rivières, comme le Gange, pouvait réellement laver les péchés et la souffrance, alors toutes les tortues, tous les crabes, poissons et coquillages vivant dans ces rivières sacrées seraient libérés de leurs péchés et de leurs souffrances ». Et encore : « Si un homme pouvait éliminer la souffrance en faisant des offrandes, en rendant hommage et en priant, plus personne au monde ne serait exposé à la souffrance car n’importe qui peut rendre hommage et prier. Or, si les gens sont encore sujets à la souffrance, bien qu’ils obéissent, rendent hommage et pratiquent des rituels, ce n’est sûrement pas la solution pour s’en libérer ».
Pour parvenir à la libération, nous devons tout d’abord examiner attentivement ce qui nous entoure, afin d’en connaître et d’en comprendre la véritable nature et, ensuite, agir en fonction de cette vérité. Tel est l’enseignement du bouddhisme, ce que nous devons savoir et garder présent à l’esprit… Le bouddhisme n’incite ni aux hypothèses ni aux suppositions mais insiste, au contraire, pour que nous agissions en accord avec notre intuition profonde. Il ne s’agit pas d’accepter aveuglément tout ce que l’on entend. Si quelqu’un affirme quelque chose, nous devons l’écouter et considérer son point de vue en toute objectivité. Si nous le trouvons raisonnable, nous pouvons l’accepter provisoirement et tenter de le vérifier par nous-mêmes. C’est là une des caractéristiques très particulière du bouddhisme, qui le distingue des autres religions du monde.
Toute religion a plusieurs facettes et peut donc prendre différents aspects selon l’angle sous lequel on la considère. Le bouddhisme, au même titre que les autres religions, a souvent été considéré à partir de différents points de vue, de sorte qu’on en a obtenu des images très variées. Parce que chacun de nous a naturellement confiance en sa propre opinion, sa vérité coïncide avec sa compréhension et son point de vue particuliers. En conséquence, la « vérité » varie selon les personnes. Nous examinons les problèmes à des niveaux différents, avec des moyens différents et des degrés d’intelligence différents. Nous pouvons difficilement admettre comme vrai ce qui dépasse notre intelligence, notre connaissance et notre compréhension. Et même si, en apparence, nous nous plions aux idées des autres, nous continuons de penser qu’il ne s’agit pas de « la » vérité telle que nous la concevons. Notre conception de la vérité peut cependant évoluer avec l’élargissement de notre intelligence, de notre savoir et de notre compréhension, jusqu’au moment où nous parvenons à la vérité ultime.
Comme nous l’avons dit, le bouddhisme est une méthode pratique dont le but est de nous libérer de la souffrance en parvenant à voir, comme l’a fait le Bouddha, la véritable nature des choses. Or tout texte religieux contient inévitablement des rajouts et notre Tipitaka ne fait pas exception. Au fil des temps, on y a ajouté des passages basés sur les idées courantes de l’époque, que ce soit pour gagner la confiance du peuple ou par excès de zèle religieux. Hélas, les rites et rituels qui se sont ainsi développés et imbriqués dans la religion sont aujourd’hui acceptés et considérés comme étant le vrai bouddhisme. Les cérémonies telles que l’offrande de plateaux de sucreries et de fruits à « l’âme » du Bouddha, semblables à l’offrande de nourriture aux moines vivants, ne sont pas en harmonie avec les principes du bouddhisme. Pourtant, certains les considèrent comme d’authentiques pratiques bouddhiques, les enseignent comme telles et les suivent très rigoureusement.
Les rites et cérémonies de cette sorte sont devenus si nombreux qu’ils ont maintenant occulté le vrai bouddhisme et son objectif originel. Prenez, par exemple, l’ordination d’un moine : elle s’est transformée en une cérémonie de remise de cadeaux au nouveau bhikkhu ; les invités sont priés d’apporter de la nourriture et d’assister aux réjouissances, et la fête se termine parfois même dans l’ivresse et le chahut, aussi bien au temple qu’à la maison ! Quant au nouveau bhikkhu, il se peut qu’il quitte la communauté religieuse quelques jours à peine après avoir été ordonné pour devenir peut-être encore plus antireligieux qu’avant. Souvenons-nous que rien de tel n’existait à l’époque du Bouddha ; ces cérémonies ne se sont développées que plus tard. Au temps du Bouddha, être ordonné signifiait simplement que, avec le consentement de ses parents, on renonçait à sa maison et à sa famille. On pouvait tirer un trait sur son passé familial et s’en aller rejoindre le Bouddha et la communauté monastique des bhikkhus. Lorsque l’occasion se présentait, on se faisait ordonner et on risquait alors de ne jamais revoir sa famille. Quelques moines, à de rares occasions, pouvaient retourner voir leurs parents mais c’était l’exception. Il existe une règle autorisant un bhikkhu à se rendre chez lui pour une raison valable mais, du temps du Bouddha, elle n’était pas observée. Enfin, les moines n’étaient pas ordonnés en présence de leurs parents, ne célébraient pas l’événement par des festivités et ne quittaient pas le Sangha au bout de quelques jours, guère plus avancés qu’avant, comme cela se produit si souvent de nos jours.
Malheureusement, ce « néo-bouddhisme » s’est répandu presque universellement. Le Dhamma, l’enseignement authentique autrefois souverain, est à présent si surchargé de cérémonies que tout l’objectif du bouddhisme en a été obscurci, falsifié et transformé. L’ordination, par exemple, est devenue une façon de sauver la face pour les jeunes gens mis à l’index, ou une nécessité préalable pour trouver une épouse, car avoir été moine est considéré comme une preuve de maturité. Pour certains, c’est une occasion de collecter de l’argent – activité pour laquelle on trouvera toujours des volontaires – et donc un moyen de s’enrichir. Cela aussi se fait appeler « bouddhisme » et quiconque se permettrait d’y trouver à redire serait considéré comme un ignorant ou même un adversaire de la religion !
L’offrande de tissu lors de la fête de Kathina est un autre exemple de dégénérescence. L’intention originelle du Bouddha était que l’on donne, à tous les moines en même temps, du tissu pour la fabrication de leurs vêtements. Cela leur permettait de les coudre tous ensemble et évitait les pertes de temps. S’il n’y avait qu’un seul vêtement, on le donnait, non pas au plus ancien des moines mais à celui que le groupe considérait comme le plus digne de le recevoir ou à celui qui en avait le plus besoin. Le vêtement était alors offert au nom de la communauté monastique tout entière. L’intention du Bouddha était de faire en sorte qu’aucun des moines n’ait une trop bonne opinion de lui-même. Ce jour-là, quel que soit le degré d’ancienneté, tout le monde devait se montrer humble et participer, au même titre, à la coupe et à la couture du tissu, à la teinture – en faisant bouillir des essences d’arbres – et à toutes les autres activités nécessaires à la confection des vêtements, en un seul et même jour. Il s’agissait d’un effort de coopération entre moines et c’est ce que souhaitait le Bouddha. Les laïcs n’y participaient pas nécessairement du tout. De nos jours, on en fait toute une histoire, il y a une cérémonie et puis des jeux et des rires bruyants. C’est même, pour certains, une occasion de gagner de l’argent. On se croirait à un pique-nique, et tous les mérites et les bons résultats que l’on aurait pu en escompter à l’origine sont perdus.
Ces dégénérescences sont une véritable tumeur qui s’est développée au sein du bouddhisme et qui fait des ravages. Elle prend des centaines d’aspects différents qu’il serait trop long d’énumérer. C’est une tumeur maligne et dangereuse qui a progressivement recouvert et obscurci la base saine, l’essence réelle du bouddhisme, qui l’a complètement défiguré. L’une des conséquences a été l’apparition de multiples sectes d’importance différente, dont certaines sont même engagées dans la sensualité ! Il est essentiel que nous apprenions à faire la différence entre ces déviations et le vrai bouddhisme originel. Nous ne devons pas nous cramponner bêtement à la coquille extérieure ou aux rituels et cérémonies, au point de perdre leur véritable objectif.
La vraie pratique du bouddhisme est basée sur la purification de la conduite à travers le corps et la parole, suivie de la purification de l’esprit, laquelle mène, à son tour, à la vision pénétrante et à la compréhension juste. N’allez pas croire que le bouddhisme est ceci ou cela sous prétexte que tout le monde le dit. De même, ceux qui appartiennent à d’autres religions ont tort de désigner ces tumeurs honteuses et disgracieuses comme étant le bouddhisme ; c’est injuste parce que ce ne sont que des excroissances. Ceux d’entre nous qui sont décidés à propager le bouddhisme, pour leur propre bien comme pour celui des autres, doivent savoir comment en saisir la véritable essence et non se cramponner à une excroissance insignifiante.
Voyons, à présent, comment les multiples facettes du bouddhisme, même authentique, peuvent conduire à une fausse compréhension. Par exemple, du point de vue d’un philosophe de la moralité, le bouddhisme est considéré comme une religion « morale ». On y parle de mérite et de démérite, de bien et de mal, d’honnêteté, de gratitude, d’harmonie, de franchise et ainsi de suite. Le Tipitaka est rempli d’enseignements d’ordre moral. De nombreux nouveaux venus au bouddhisme s’en approchent par cet angle, attirés par ses vertus.
Un aspect plus profond du bouddhisme apparaît lorsqu’on le considère sous l’angle de la vérité, une vérité profondément enfouie sous la surface et invisible à l’homme ordinaire. Voir cette vérité, c’est connaître intellectuellement la vanité de toute chose, l’impermanence, l’insatisfaction et le non-soi ; c’est connaître intellectuellement la nature de la souffrance, de l’élimination totale de la souffrance ; c’est percevoir tout ceci en termes de vérité absolue, de cette vérité qui ne changera jamais et que tous devraient connaître. Tel est le bouddhisme en tant que vérité.
Le bouddhisme en tant que religion est une méthode pratique basée sur la vertu, la concentration et la connaissance, et qui culmine en libérant la vision pénétrante intuitive. Cette méthode, lorsqu’elle est pratiquée jusqu’au bout, permet de se libérer de la souffrance. Tel est le bouddhisme en tant que religion.
Ensuite vient le bouddhisme en tant que psychologie, comme il nous est présenté dans la troisième partie du Tipitaka, où la nature de l’esprit est décrite de façon remarquablement détaillée. Aujourd’hui encore, la psychologie du bouddhisme est source d’intérêt et d’émerveillement pour les chercheurs de l’esprit car elle est beaucoup plus profonde que les connaissances actuelles en psychologie.
Vu sous un autre angle encore, le bouddhisme est une philosophie. En philosophie, la connaissance peut être clairement perçue au moyen de preuves raisonnées et logiques mais elle ne peut être démontrée expérimentalement. Elle s’oppose à la science dont la connaissance résulte de l’observation visuelle, d’expériences physiques et de tests ou même du « regard intérieur » de l’intuition. Un concept aussi profond que celui du « vide » (l’impermanence) n’est que philosophie pour celui qui n’en a pas encore pénétré la vérité mais il est science pour qui l’a saisi parfaitement, pour un être réalisé, un Arahant, qui l’a vu clairement, intuitivement.
De nombreux aspects du bouddhisme, en particulier les Quatre Nobles Vérités, sont scientifiques en ce qu’ils peuvent être vérifiés par une preuve expérimentale claire, au moyen de l’introspection. Toute personne dotée d’une capacité d’observation et intéressée par l’étude et la recherche, peut y trouver, comme dans la science, des rapports de cause à effet. Mais le bouddhisme n’est pas une vague chose obscure, ce n’est pas une simple philosophie comme le sont les disciplines fabriquées par les hommes.
Certains considèrent le bouddhisme comme une culture. Les véritables connaisseurs y découvrent de nombreux aspects communs à toutes les cultures mais aussi d’autres, typiquement bouddhiques.
De toutes ces différentes facettes du bouddhisme, celle à laquelle un vrai bouddhiste se doit d’attacher le plus d’importance est le bouddhisme en tant que religion. Le bouddhisme est avant tout une méthode pratique et directe permettant d’acquérir la connaissance de la véritable nature des choses, connaissance qui permet d’abandonner toute forme de convoitise, d’attachement, d’ignorance et d’engouement, et de devenir totalement indépendant. C’est ainsi que l’on pénètre au cœur même du bouddhisme. Vu sous cet angle, le bouddhisme est beaucoup plus utile qu’en tant que simple système moral ou en tant que vérité limitée à une connaissance profonde mais théorique ; plus utile qu’en tant que philosophie, objet de spéculation et de discussion mais qui ne mène pas à l’abandon des pollutions de l’esprit ; et certainement plus utile que vu comme une culture, un comportement attirant qui n’intéresse que les sociologues.
A tout le moins, chacun devrait considérer le bouddhisme comme un art, comme l’art de vivre. En effet, il incarne une capacité et une compétence à se comporter en être humain, à vivre de façon exemplaire, digne d’éloges, propre à impressionner et à émuler tout son entourage. Ce qu’il faut faire, c’est cultiver « les trois vertus » : tout d’abord développer la pureté morale, ensuite habituer l’esprit au calme et à la stabilité pour qu’il soit capable de faire son travail au mieux, et enfin donner naissance à une telle abondance de sagesse et une vision si claire de la nature réelle des choses que celles-ci ne seront plus en mesure de causer de la souffrance. On peut dire que celui dont la vie est éclairée par ces trois vertus a parfaitement maîtrisé l’art de vivre. Les Occidentaux sont intéressés par cet aspect du bouddhisme et le discutent plus que tout autre. Il est certain qu’il permet de pénétrer si profondément dans la véritable essence du bouddhisme qu’il en devient notre guide dans la vie, engendre une joie et un enthousiasme spirituels tout en dissipant dépression et désillusion. Il chasse aussi les peurs, comme la peur que l’abandon total de tout ce qui pollue de l’esprit (avidité, négativité et ignorance) rende la vie terne, inintéressante et insipide, ou la peur qu’un complet détachement bloque le fonctionnement de la pensée et de l’action ; alors qu’en réalité, celui qui mène sa vie selon l’art de vivre bouddhiste maîtrise tout ce qui l’entoure. Qu’il s’agisse d’animaux, de personnes, de biens ou de tout autre chose, et que ces choses pénètrent sa conscience par la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher ou la pensée, elles seront inévitablement vaincues, incapables d’obscurcir sa vision, de le tromper ou de le perturber. La victoire sur toutes ces choses engendre la joie pure.
Le Bouddha-Dhamma ravira l’esprit de ceux qui s’y seront intéressés. Il peut aussi être considéré comme une forme indispensable de nourriture. Il est vrai que l’individu qui est toujours sous l’emprise des pollutions qui obscurcissent l’esprit désire toujours se nourrir par le biais des yeux, des oreilles, du nez, du palais et du corps et qu’il poursuit cette recherche selon sa nature. Mais il existe aussi quelque chose en lui de plus profond qui ne recherche pas cette sorte de nourriture : c’est l’élément pur et libre de son esprit qui aspire à la joie et au nectar de la nourriture spirituelle, à commencer par les délices qu’apporte la pureté morale. Cette nourriture spirituelle est la source de contentement des êtres pleinement éveillés ; ils ont une telle tranquillité intérieure que les pollutions qui obscurcissent normalement l’esprit ne peuvent les perturber ; ils ont une vision claire de la véritable nature des choses et aucun désir pour elles. Ces êtres sont capables de se poser sans avoir à courir ici et là comme ces gens dont le Bouddha disait qu’ils étaient « fumée la nuit, feu le jour ».
« Fumée la nuit » signifie insomnie, agitation. Celui qui souffre de ces maux passe la nuit la main sur le front, soucieux de ce qu’il doit faire, réfléchissant à la meilleure façon de s’enrichir et de se procurer tout ce qu’il désire. Son esprit est plein de « fumée ». Tout ce qu’il peut faire, c’est rester allongé jusqu’au matin ; il pourra alors se lever et courir satisfaire les désirs de la « fumée » qu’il a retenue toute la nuit – et c’est cette activité fiévreuse que le Bouddha appelle « feu le jour ». Ces symptômes révèlent un esprit qui n’a pas trouvé la tranquillité, un esprit privé de nourriture spirituelle, qui souffre d’une faim et d’une soif pathologiques dues à la convoitise. Toute la nuit, la victime retient la « fumée » et la chaleur qui, devenue feu au matin, brûlera en lui toute la journée. Si l’on doit passer sa vie à étouffer la fumée de nuit puis attiser le feu de jour, comment trouvera-t-on jamais la fraîcheur et la sérénité de la paix ? Essayez d’imaginer un peu cette situation : endurer cette souffrance, ce tourment, toute sa vie, de la naissance jusqu’à la mort, simplement parce que l’on n’aura pas su développer la vision pénétrante qui aurait complètement éteint feu et fumée. Pour soigner ce mal, il faut utiliser la connaissance – les « remèdes » – que nous a léguée le Bouddha. Alors la fumée et le feu diminueront proportionnellement au degré de compréhension que l’on aura de la véritable nature des choses.
Comme nous l’avons vu, le bouddhisme a plusieurs facettes ou aspects différents. De même qu’une montagne se présente différemment selon qu’on la regarde d’un point de vue ou d’un autre, les avantages que l’on peut retirer du bouddhisme varient selon la façon dont on le considère. Comme les autres religions, le bouddhisme est né de la peur des hommes – pas la peur des fous ignorants qui se prosternent aux pieds d’idoles ou de phénomènes surnaturels mais une forme de peur plus raffinée, la peur de n’être jamais libéré de l’oppression que représentent la naissance, la vieillesse, la douleur et la mort, libéré de toutes les différentes formes de souffrance que nous connaissons. Le vrai bouddhisme n’est pas ce que l’on trouve dans les livres, ce n’est pas la répétition littérale du Tipitaka, pas plus que les rites ou les rituels. Le vrai bouddhisme est une pratique qui détruit les « pollutions » qui obscurcissent l’esprit, partiellement ou totalement, au moyen du corps, de la parole et de la pensée. Pour cela, point n’est besoin de consulter livres ou manuels, de s’appuyer sur des rites ou sur tout autre élément extérieur, y compris esprits et êtres célestes. Mieux vaut se concentrer directement sur les mouvements du corps, de la parole et de la pensée ; autrement dit, persévérer dans l’effort qui consiste à éliminer ce qui obscurcit l’esprit et permettre ainsi à la claire vision pénétrante de s’éveiller. Nous serons alors automatiquement capables d’agir de façon appropriée dans toutes les situations. Nous serons libérés de la souffrance dès cet instant et jusqu’à la fin de nos jours. Voilà le vrai bouddhisme tel que nous devons le comprendre.
Chapitre II
LA VÉRITABLE NATURE DES CHOSES
Le mot « religion » a un sens plus vaste que le mot « moralité ». La moralité traite du comportement et du bonheur, et on la retrouve à peu près semblable dans tous les coins du monde. Une religion est une méthode de pratique de haut niveau et les façons de pratiquer varient énormément d’une religion à l’autre. La moralité fait de nous des personnes honnêtes, nous fait agir selon les principes de la vie en société, de façon à ne causer de mal à personne. Pourtant, même si un individu est profondément vertueux, il souffrira, comme les autres, de tout ce qui se rattache à la naissance, la vieillesse, la douleur et la mort, et sera opprimé par les obscurcissements de l’esprit. La moralité est loin de permettre l’élimination de la convoitise, de l’aversion et de l’ignorance ; elle ne peut donc pas supprimer la souffrance. Tandis que la religion – et le bouddhisme en particulier – va beaucoup plus loin : elle vise directement à l’élimination complète des pollutions de l’esprit et donc à l’extinction des différentes formes de souffrance liées à la naissance, la vieillesse, la douleur et la mort. Cela prouve que la religion se distingue de la simple moralité et que le bouddhisme va beaucoup plus loin que les systèmes moraux du monde en général. Ceci étant bien clair, nous pouvons à présent orienter notre attention vers le bouddhisme lui-même.
Le bouddhisme est une méthode dont le but est d’apporter une connaissance technique inséparable de sa pratique, et d’apporter une compréhension pratique et structurée de la véritable nature des choses. En gardant bien à l’esprit cette définition, vous n’aurez aucun mal à comprendre le bouddhisme.
Interrogez-vous et voyez si, oui ou non, vous percevez les choses telles qu’elles sont réellement. Même si vous savez ce que vous êtes, ce qu’est la vie, ce que sont le travail, le devoir, les moyens d’existence, l’argent, les biens, l’honneur et la célébrité, oseriez-vous prétendre que vous connaissez tout à fond ? Si nous connaissions vraiment les choses telles qu’elles sont, nous n’agirions jamais de façon inadéquate et, si nous agissions toujours de façon adéquate, il est certain que nous ne serions jamais sujets à la souffrance. Il se trouve que nous ignorons la véritable nature des choses et, en conséquence, nous nous comportons seulement de façon plus ou moins adéquate, ce qui engendre inévitablement la souffrance. La pratique bouddhique a pour but de nous apprendre « ce qui est » réellement. Savoir ce qui est, parfaitement clairement, c’est parvenir au fruit de la Voie, peut-être même au fruit final, le Nirvana, parce que c’est cette connaissance qui détruit les pollutions de l’esprit.
Quand nous en arrivons à connaître « ce qui est », c’est-à-dire la véritable nature des choses, le désenchantement prend le pas sur la fascination, et nous sommes automatiquement délivrés de la souffrance. Pour le moment, nous pratiquons à un niveau où nous ne connaissons toujours pas la véritable nature des choses et, en particulier, nous n’avons pas encore réalisé que tout est impermanent et dépourvu d’un « soi » personnel. Nous ne réalisons pas encore que la vie, toutes les choses auxquelles nous sommes attachés, que nous aimons, désirons et apprécions, sont impermanentes, insatisfaisantes et vides de tout « soi ». C’est pour cette raison que nous en sommes entichés, que nous les aimons, nous les désirons, nous nous réjouissons de les posséder, nous nous y attachons avidement. Quand, en suivant les enseignements du Bouddha, nous en arrivons à voir les choses correctement, à voir clairement qu’elles sont toutes impermanentes, insatisfaisantes et dépourvues de « soi », qu’elles ne valent pas la peine que l’on s’y attache, il se produit immédiatement une sorte de glissement qui nous libère du pouvoir dominateur des choses.
Dans son essence, l’enseignement du Bouddha, tel qu’il apparaît dans le Tipitaka, n’est autre que la connaissance de la véritable nature des choses – ni plus ni moins. Tenez-vous en à cette définition : elle est exacte et il est bon de l’avoir en esprit pendant la pratique.
A présent, nous allons démontrer la validité de cette définition en prenant pour exemple les Quatre Nobles Vérités.
La Première Noble Vérité, qui fait apparaître que tout est souffrance ou cause de souffrance, nous dit précisément ce qu’il en est de toutes choses. Mais comme nous ne parvenons pas à comprendre tout ce qui est source de souffrance, nous désirons ces choses-là. Si nous les voyions comme sources de souffrance, à coup sûr, nous n’en voudrions pas.
La Seconde Noble Vérité montre que le désir est la cause de la souffrance. Les gens ne savent toujours pas, ne voient pas, ne comprennent pas que les désirs sont causes de souffrance. Ils désirent tous ceci ou cela, simplement parce qu’ils ne comprennent pas la nature du désir.
Le Troisième Noble Vérité montre que la délivrance – c’est-à-dire la libération de la souffrance ou Nirvana – consiste en l’extinction totale du désir. Les gens ne comprennent pas que le Nirvana est un état qui peut être atteint à tout moment et en tout lieu, à l’instant précis où le désir disparaît totalement. Ainsi, n’ayant aucune connaissance de la réalité des choses, ils ne s’intéressent pas au Nirvana parce qu’ils ne savent pas ce que c’est.
La Quatrième Noble Vérité est appelée « la Voie » ou « l’Octuple Sentier ». C’est la méthode qui permet d’éliminer tout désir. Personne ne la comprend ainsi, personne ne s’intéresse à l’Octuple Sentier qui abolit le désir. Les gens ne voient pas qu’il s’agit là du soutien dont ils ont précisément besoin, d’un point d’appui qu’ils devraient s’empresser de consolider. Ils ne s’intéressent pas au Noble Sentier du Bouddha qui est pourtant un joyau parfait et précieux parmi la masse des connaissances humaines. C’est une ignorance épouvantable.
Nous voyons donc que les Quatre Nobles Vérités nous informent clairement sur la véritable nature des choses. Il nous est dit que, si nous jouons avec le désir, il engendrera la souffrance… et pourtant nous persistons à jouer avec lui jusqu’à n’en plus pouvoir de souffrir ! C’est tragiquement ridicule ! Ne connaissant pas la véritable nature des choses, nos actions sont inadéquates en tous points. Trop rares sont les circonstances où nous agissons de manière appropriée ; en général nos actions ne sont appropriées que selon la norme des personnes sujettes à l’attachement et pour lesquelles la fin justifie les moyens. Mais, sur le plan spirituel, ces actions sont injustifiables.
Nous allons maintenant nous pencher sur un passage des textes du Canon Pali qui résume l’essence du bouddhisme. Il s’agit des paroles que le bhikkhu Assaji adressa à Sariputta quand celui-ci lui demanda de résumer l’essence du bouddhisme en quelques mots. Assaji répondit : « Tout phénomène naît d’une cause. Le Bouddha a montré quelles sont les causes et comment tous les phénomènes peuvent disparaître quand on en élimine les causes. Voilà ce qu’enseigne le Maître ». Ce qu’il a dit, en fait, c’est qu’à l’origine de tout phénomène, il y a des causes qui se sont combinées pour lui donner naissance. Le phénomène ne peut être éliminé tant que les causes ne l’auront pas été.
Ceci est un avertissement : ne considérons rien comme ayant une réalité propre et permanente. Rien n’est permanent. Il n’y a que des effets qui apparaissent suite à des causes, qui se développent en fonction de ces causes, et qui disparaissent à la cessation de ces causes. Le monde n’est qu’un flux perpétuel de forces naturelles qui ne cessent de s’entrecroiser et de changer. Le bouddhisme nous montre que tout est dépourvu d’identité propre. Il n’y a qu’un flux en perpétuel changement, ce qui est fondamentalement insatisfaisant du fait de l’absence de liberté et de l’assujettissement à la loi de cause à effet. Cette insatisfaction prendra fin dès que le processus s’arrêtera, et le processus s’arrêtera dès que les causes seront éliminées et qu’il n’y aura donc plus d’interaction.
C’est là un exposé très profond de la véritable nature de toute chose que seul un être éveillé pouvait donner. C’est le cœur du bouddhisme. Il nous est dit que tout n’est qu’apparence et que nous ne devons pas tomber dans le piège d’aimer ceci ou détester cela. Libérer réellement l’esprit signifie échapper complètement à la chaîne de causalité, en éliminer radicalement les causes. Ainsi l’insatisfaction engendrée par les phénomènes d’attirance et de répulsion sera anéantie.
Penchons-nous, à présent, sur l’intention du Bouddha lorsqu’il a choisi de devenir ascète. Quelle a été sa motivation ? La réponse est clairement indiquée dans l’un de ses discours : il a quitté son foyer et il est devenu moine pour trouver une réponse à la question : « Qu’est-ce que le bien ? » Le mot « bien » (kusala) tel qu’il est utilisé ici, signifie « perfection », connaissance de la vérité absolue. Il voulait connaître, en particulier, ce que sont la souffrance, la cause de la souffrance, et la libération de la souffrance. Atteindre la connaissance absolue est l’ultime perfection. L’objectif du bouddhisme n’est autre que cette connaissance parfaite de la véritable nature des choses.
Autre élément important de l’enseignement du bouddhisme : les Trois Caractéristiques, c’est-à-dire l’impermanence (anicca), l’insatisfaction ou souffrance (dukkha) et le non-soi (anattā). Ignorer cet enseignement, c’est ignorer le bouddhisme. Il montre que tout est impermanent, tout est insatisfaisant et dépourvu de « soi ».
- Dire que tout est impermanent signifie que tout est en perpétuel changement du fait qu’il n’y a aucune entité (ou « soi ») qui reste inchangée, ne serait-ce qu’un instant.
- Dire que tout est insatisfaisant signifie qu’en toutes choses se trouve une source inhérente de souffrance et de tourment. De par leur nature, elles ne peuvent qu’inspirer répulsion et désenchantement.
- Dire qu’il n’existe pas de soi signifie qu’il n’existe nulle part la moindre entité que l’on aurait le droit de considérer comme une « personne » (moi) ou appeler « sien » (à moi). Si nous nous saisissons des choses et nous attachons à elles, nous n’en retirerons que souffrance.
Les choses matérielles sont plus dangereuses que le feu parce qu’un incendie est visible de loin, ce qui permet d’éviter de s’en approcher ; tandis que les choses sont un feu invisible que nous allons délibérément saisir à pleines mains, ce qui ne peut manquer d’être douloureux.
Cet enseignement nous éclaire sur la nature des choses selon les Trois Caractéristiques. Le bouddhisme apparaît simplement comme une méthode pratique et structurée, destinée à nous montrer les choses telles qu’elles sont.
Nous avons vu combien il est important de connaître la nature réelle des choses. Il nous faut également savoir comment pratiquer pour agir en accord avec cette nature. Il existe un autre enseignement dans les textes, connu comme « l’enseignement majeur ». Il se résume à trois points : éviter le mal, faire le bien et purifier l’esprit. Tel est le principe de la pratique. Savoir que tout est impermanent, sans valeur et pas « nôtre », que rien ne vaut donc que l’on s’en saisisse et que l’on s’y attache, doit nous inciter à agir en conséquence et avec prudence ; c’est ce qui s’appelle éviter le mal. Cela implique ne pas enfreindre le code moral en vigueur et renoncer à la convoitise et à l’attachement excessifs. D’un autre côté, il faut faire le bien – le bien tel que l’ont compris les sages. Ces deux éléments ne sont que des niveaux de moralité. Le troisième, par contre, selon lequel nous devons purifier notre esprit de tout type de contamination, est du bouddhisme pur. Il nous dit de libérer notre esprit. Tant que l’esprit est sous la domination des pensées et des émotions – que l’on appelle « les objets de l’esprit » – il ne peut pas être propre et pur. La liberté de l’esprit doit venir d’une connaissance extrêmement profonde de la nature de ses objets. Sans cette connaissance, nous continuerons inévitablement à errer aveuglément, d’attirance en répulsion, d’une manière ou d’une autre. Tant que nous réagirons ainsi, nous ne pourrons pas nous prétendre libres.
Fondamentalement, nous, êtres humains, sommes sujets à deux sortes d’états émotionnels, pas plus : l’attirance et la répulsion (lesquels correspondent à des sensations de l’esprit agréables et désagréables). Nous sommes esclaves de nos humeurs et n’avons aucune liberté réelle du simple fait que nous ne connaissons pas la véritable nature de ces humeurs ou des choses telles qu’elles sont réellement. Lorsque nous aimons une chose, nous voulons nous en emparer, l’accaparer. Lorsqu’une chose nous répugne, nous cherchons à la repousser, à nous en débarrasser. Tant que ces deux états émotionnels existent, l’esprit n’est pas libre. Tant qu’il continue négligemment à aimer ceci et à détester cela, il ne pourra en aucun cas être purifié et libéré de la tyrannie de ses réactions. C’est pour cela que l’enseignement le plus élevé du bouddhisme condamne l’attachement aux choses attirantes ou répugnantes, et va même jusqu’à condamner, en dernier ressort, l’attachement au bien et au mal. Quand l’esprit est purifié de ces deux réactions émotionnelles, il devient indépendant.
D’autres religions recommandent simplement d’éviter le mal et de s’attacher au bien, de s’y attacher jusqu’à inclure le bien par excellence : Dieu. Le bouddhisme va beaucoup plus loin en condamnant toute forme d’attachement. L’attachement au bien est une pratique juste à un niveau intermédiaire mais, quoi que nous fassions, il ne pourra nous mener au niveau le plus élevé. Au niveau le plus bas, nous évitons le mal, ensuite nous faisons notre possible pour faire le bien mais, au niveau le plus élevé, nous amenons l’esprit à s’envoler au-delà de la domination du bien et du mal.
Tant que l’on est attaché aux fruits des bonnes actions, il n’y a pas de libération totale de la souffrance car, tout comme une personne méchante souffre proportionnellement à sa méchanceté, une bonne personne souffre proportionnellement à sa bonté. Quand on est bon, on souffre comme les personnes bonnes peuvent souffrir. Un être céleste bon ressent la souffrance qui échoit aux êtres célestes et même un dieu souffre en fonction de sa nature divine. La libération totale de la souffrance n’intervient que lorsqu’un être est libéré et qu’il a même dépassé ce que l’on appelle « le bien », pour devenir un ariyan, celui qui a transcendé la condition humaine et fini par devenir un être totalement parfait, un Arahant.
Comme nous l’avons vu, le bouddhisme est l’enseignement du Bouddha, l’Eveillé, et un bouddhiste est une personne qui met en pratique ses enseignements. En quoi le Bouddha a-t-il été éveillé ? Simplement dans la mesure où il a compris la véritable nature de toute chose. Le bouddhisme est donc l’enseignement qui nous montre la vérité de ce qui est. A nous de le pratiquer jusqu’à connaître cette vérité par nous-mêmes. Nous pouvons être assurés que, dès que nous aurons atteint cette connaissance parfaite, tout désir disparaîtra, car la connaissance s’élève à l’instant même où l’ignorance disparaît.
Dans le bouddhisme, chaque aspect de la pratique a pour but de développer la connaissance. C’est simplement pour acquérir cette connaissance que vous engagez votre esprit sur la voie de la pratique qui pénétrera au cœur du Bouddha-Dhamma. Mais faites en sorte que ce soit une connaissance juste, obtenue par la claire vision pénétrante, et non une connaissance mondaine, partielle, qui risque, par exemple, de prendre le mal pour le bien, et de croire qu’une source de souffrance sera source de bonheur. Essayez vraiment de considérer les choses en termes de souffrance et vous en viendrez à cette connaissance, progressivement, pas à pas. Cette connaissance-là sera la connaissance du bouddhisme, basée sur de solides principes.
En utilisant cette méthode, une personne simple et sans éducation sera capable de pénétrer l’essence du bouddhisme, tandis qu’un érudit religieux, aux nombreux titres universitaires, totalement absorbé par l’étude du Tipitaka mais qui ne considère pas les choses de ce point de vue, peut ne pas du tout pénétrer l’enseignement. Ceux d’entre nous qui sont dotés d’une certaine intelligence devraient être en mesure d’étudier et observer les choses à fond, jusqu’à en connaître la véritable nature. Nous devons observer absolument tous les phénomènes que nous rencontrons, en comprendre la nature, mais aussi trouver la source de la souffrance qu’ils causent, cette souffrance qui nous enflamme et nous brûle. S’établir dans l’attention, observer et attendre, examiner, comme cela a été expliqué, la souffrance qui nous arrive : telle est la meilleure façon de pénétrer le Bouddha-Dhamma. C’est beaucoup plus profitable que de l’étudier à partir du Tipitaka. S’employer activement à étudier le Dhamma dans le Tipitaka, du point de vue linguistique ou littéraire, ne permet en aucun cas de découvrir la véritable nature des choses. Bien entendu, le Tipitaka est rempli d’explications sur la nature des choses, mais le problème est que les gens les écoutent à la manière des perroquets, pour les répéter plus tard, comme ils auront pu les retenir. Ils sont incapables de pénétrer eux-mêmes la véritable nature des choses. Si, au contraire, ils pratiquaient l’introspection et découvraient par eux-mêmes comment fonctionne l’esprit, si leur propre exemple les amenait à voir de près le mécanisme de ces pollutions qui obscurcissent l’esprit, de la souffrance, de la nature – autrement dit, de tout ce qui fait leur vie – ils seraient alors en mesure de pénétrer le véritable Bouddha-Dhamma.
Un individu peut très bien n’avoir jamais lu ou entendu parler du Tipitaka, s’il s’astreint à une observation approfondie à chaque fois que la souffrance vient le brûler, on peut dire de lui qu’il étudie le Tipitaka directement et beaucoup plus correctement que les gens qui le lisent. Ces derniers peuvent se contenter de caresser chaque jour les livres, sans avoir conscience du Dhamma immortel qu’ils contiennent. De même, nous avons notre propre personne à disposition à chaque instant, mais nous nous engageons dans toutes sortes de choses sans rien savoir de nous-mêmes, sans être capables de régler nos propres problèmes. Nous sommes toujours sujets à la souffrance, prisonniers de la convoitise qui vient augmenter cette souffrance chaque jour de notre vie, simplement parce que nous ne connaissons toujours pas le fonctionnement de notre esprit.
Il est extrêmement difficile de comprendre le Tipitaka et les vérités profondes qu’il renferme, alors commençons plutôt par étudier le Bouddha-Dhamma en apprenant à connaître notre véritable nature. Apprenons à connaître toutes les choses qui constituent ce corps et cet esprit. Apprenons les leçons de la vie, cette vie qui tourne sans fin dans le cycle du désir, de l’action liée au désir, de la soif des fruits de l’action, lesquels renforcent à nouveau l’envie d’en avoir toujours plus, et ainsi de suite à l’infini ; cette vie soumise au cercle vicieux du samsāra, l’océan de souffrance, purement et simplement à cause de l’ignorance de la véritable nature des choses.
En résumé, le bouddhisme est une méthode pratique et structurée dont le but est de nous révéler les choses telles qu’elles sont réellement. Une fois que nous avons vu leur véritable nature, nous n’avons plus besoin de personne pour nous enseigner ou nous aider, nous pouvons continuer à pratiquer seuls. Le progrès que nous faisons sur la Voie de l’ariyan suit le rythme auquel nous éliminons les pollutions de l’esprit et nous abandonnons les actions erronées. Finalement, nous atteindrons ce qui peut arriver de mieux à un être humain, ce que l’on appelle le fruit de la Voie, le Nirvana. Nous pouvons y parvenir seuls, simplement en apprenant à comprendre le sens ultime de la véritable nature des choses.
Chapitre III
LES TROIS CARACTÉRISTIQUES UNIVERSELLES
A présent nous allons étudier en détail les trois caractéristiques communes à toutes choses : l’impermanence, l’insatisfaction (ou la souffrance) et le non-soi.
Tout change constamment dans ce monde, tout est instable. La caractéristique de toute chose est de n’apporter qu’insatisfaction, désillusion et désenchantement à qui en perçoit clairement la nature impermanente. Enfin, rien ne permet de dire que quoi que ce soit dans ce monde nous appartienne en propre. Les choses paraissent « personnelles » aux yeux non avertis mais, dès que notre vision s’éclaircit et se précise, nous réalisons qu’il n’existe aucune entité personnelle.
Dans son enseignement, le Bouddha a tout particulièrement mis l’accent sur ces trois caractéristiques. L’enseignement tout entier peut se résumer simplement à un regard pénétrant sur l’impermanence, l’insatisfaction et le non-soi. Parfois ces éléments sont mentionnés explicitement, parfois exprimés dans d’autres termes mais, fondamentalement, ils visent à démontrer la même vérité. L’impermanence de toute chose avait été enseignée avant l’époque du Bouddha mais n’avait pas été développée aussi profondément qu’il l’a fait. De même l’insatisfaction avait été enseignée, mais pas dans toues ses facettes. Elle n’avait pas été traitée du point de vue de la causalité, et aucun enseignement n’avait été donné pour permettre de l’éradiquer complètement et définitivement. Les maîtres qui ont précédé le Bouddha n’en avaient pas compris la véritable nature comme il le fit lors de son Eveil. Quant au non-soi, au sens ultime du terme, il n’est enseigné que dans le bouddhisme. Seul le Bouddha, grâce à une compréhension totale et profonde de « ce qui est », c’est-à-dire de la véritable nature des choses, a enseigné que quiconque a parfaitement compris « ce qui est » saura que rien, absolument rien n’est « soi » ou n’appartient à un soi.
Il existe de nombreuses techniques pour permettre de développer une vision pénétrante de ces trois caractéristiques et, immanquablement, un simple fait se révélera alors aussitôt : rien ne justifie la convoitise et l’attachement, rien ne vaut la peine que nous voulions absolument l’obtenir, le posséder ou le devenir. Bref : rien ne vaut la peine d’être obtenu, rien de vaut la peine de devenir ou d’être vécu. Ce n’est que lorsque l’on comprend que posséder ou être quoi que ce soit n’est qu’une illusion, une tromperie, un mirage, que rien n’en vaut la peine, que l’on atteint la véritable vision pénétrante de l’impermanence, de l’insatisfaction et du non-soi. Vous pouvez réciter du matin au soir « anicca, dukkha, anattā », des centaines et des milliers de fois, sans être capable de comprendre et de voir ces caractéristiques. De par leur nature, il est impossible de vraiment les voir si on se contente de les entendre ou de les réciter.
La vision pénétrante intuitive, que nous appelons aussi « vision du Dhamma », est très différente de la pensée rationnelle, laquelle ne permettra jamais de voir le Dhamma. La vision pénétrante intuitive ne peut s’obtenir qu’au moyen d’une réalisation intérieure authentique. Supposons, par exemple, que nous examinions une situation dans laquelle nous nous sommes laissé entraîner et qui nous a ensuite fait souffrir. Si, en observant de près le cours des événements, nous ressentons un réel désenchantement, une lassitude, une désillusion, nous pourrons dire que nous avons vu le Dhamma ou que nous avons obtenu une perception claire des choses. Cette perception peut se développer, avec le temps, jusqu’à se perfectionner et avoir le pouvoir de nous libérer de toutes choses. Si vous répétez « anicca, dukkha, anattā » ou que vous examinez les trois caractéristiques jour et nuit mais sans jamais vous lasser des choses, sans perdre le désir d’avoir ou d’être quelque chose, ou le désir de vous saisir des choses, vous n’avez pas encore atteint la vision pénétrante. En résumé, la perception claire de l’impermanence, de l’insatisfaction et du non-soi consiste à réaliser que rien de vaut la peine d’être obtenu ou vécu.
Il existe un mot, dans le bouddhisme, qui traduit exactement cela, c’est le mot « suññata » ou « vide », vide de soi, vide d’une essence à laquelle nous aurions le droit de nous cramponner de toutes nos forces comme étant « nôtre ». L’observation qui mène à la vision claire que tout est dénué d’essence est le noyau central, la clé de la pratique du bouddhisme. Lorsque nous avons compris réellement que tout, absolument tout, est dénué de « soi », nous pouvons dire que nous connaissons le Bouddha-Dhamma à fond. La simple expression « vide de soi » résume l’impermanence (anicca), l’insatisfaction (dukkha) et le non-soi (anattā). Quand une chose est en perpétuelle évolution, dénuée de tout élément permanent et stable, on peut aussi dire qu’elle est « vide ». Quand on voit qu’elle est capable de nous induire en erreur, on peut la décrire comme vide de toute entité à laquelle nous aurions le droit de nous cramponner. Et lorsque nous découvrons, après examen, que cette chose ne possède aucun élément stable qui serait son essence, que ce n’est qu’un élément de la nature qui change et qui fluctue selon les lois de la nature que nous n’avons aucune raison de dire « nôtres », il ne nous reste qu’à conclure que cette chose est dépourvue de soi. Dès qu’un individu en vient à percevoir le vide de toute chose, naît en lui la réalisation rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Ce sentiment a le pouvoir de le protéger de la domination des pollutions qui obscurcissent l’esprit et des réactions émotionnelles. Lorsqu’un individu a atteint ce niveau, il lui devient impossible d’avoir un état d’esprit malsain, il ne se laisse plus entraîner à réagir brusquement à quoi que ce soit, rien ne peut plus l’attirer ou le séduire. Son esprit découvre une liberté et une indépendance permanentes, et il est libéré de toute souffrance.
Cette phrase « rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu » doit être comprise dans sa signification particulière. Les mots « obtenu » et « vécu » se réfèrent ici au fait de chercher à posséder et à exister avec un esprit confus, avide et possessif. Nous ne suggérons pas de vivre sans « avoir » ni « être » quoi que ce soit. Il y a des choses dont on ne peut généralement pas se passer : une propriété, des enfants, une épouse, un jardin, des champs, etc. On se sent obligé d’être bon ; on ne peut s’empêcher d’être un gagnant ou un perdant, ni d’avoir une condition sociale ou une autre ; on ne peut éviter d’être une chose ou une autre. Pourquoi, alors, nous apprend-on à considérer les choses comme n’ayant aucune valeur ? Voici la réponse : les concepts « avoir » et « être » sont purement relatifs, ce sont des idées de ce monde basées sur l’ignorance. En termes de réalité pure ou de vérité absolue, nous ne pouvons rien avoir ni être. Pourquoi ? Simplement parce que la personne qui veut posséder et la chose à posséder sont toutes deux impermanentes, insatisfaisantes et n’appartiennent à personne. Pourtant un individu qui ne perçoit pas cela pensera naturellement : « J’obtiens ceci, j’ai cela, je suis ainsi ». Nous pensons automatiquement en ces termes et c’est ce concept même qui est à la source de notre désespoir et de notre malheur.
Avoir et être représentent une forme de désir, le désir de ne pas laisser la chose que l’on est en train d’acquérir ou d’être, disparaître ou s’éloigner. La souffrance naît du désir d’avoir et du désir d’être – bref, du désir. Quant au désir, il naît de l’ignorance du fait que, fondamentalement, les choses n’ont rien de désirable. La fausse idée selon laquelle les choses sont désirables apparaît, comme un instinct, dès le plus jeune âge, et engendre le désir. Suite à ce désir, des actions seront entreprises et des résultats obtenus, satisfaisants ou pas. Si notre désir est satisfait, il engendrera un désir encore plus grand ; dans le cas contraire, il y aura inévitablement lutte et efforts jusqu’à ce que, d’une manière ou une autre, le désir soit satisfait. Cette attitude nous enchaîne à un cercle vicieux : action (karma), résultat, action, résultat – c’est ce que l’on appelle « la roue du samsāra ». Le mot samsāra ne se réfère pas, comme on le croit souvent, à un cercle sans fin d’une existence physique après l’autre. Il se réfère en réalité au cercle vicieux de trois éléments : le désir, l’action qui naît de ce désir, et les effets qui résultent de l’action. Ensuite il y a l’incapacité à cesser de désirer – comme une obligation de désirer à nouveau – qui entraîne une nouvelle action et un autre effet, lequel ne fait qu’augmenter encore le désir, et ainsi de suite à l’infini. Le Bouddha a appelé cela la « roue » du samsāra parce que c’est un cercle sans fin qui continue à tourner. C’est précisément à cause de ce cercle que nous devons endurer souffrance et tourments. Réussir à échapper à ce cercle vicieux, c’est atteindre la libération de toutes les formes de souffrance, autrement dit, le Nirvana. Que l’on soit pauvre ou millionnaire, roi ou empereur, être céleste ou dieu, tant que l’on est pris dans ce cercle vicieux, on ne peut éviter la souffrance et le tourment qui correspondent au désir. C’est pourquoi nous pouvons dire que cette roue du samsāra regorge de souffrance. Pour résoudre ce problème, nous ne pouvons nous contenter de sīla, la moralité ou vertu ; nous devons nous appuyer sur les principes les plus élevés du Dhamma.
Nous avons vu que la souffrance naît de la soif du désir, comme le Bouddha l’a déclaré dans sa Seconde Noble Vérité. Nous verrons maintenant que cette « soif » se décline sous trois formes. La première est le désir sensoriel : désirer des choses – formes, couleurs, sons, parfums, saveurs ou objets tactiles – et y trouver du plaisir. La seconde forme est le désir de devenir, d’exister en tant que ceci ou cela, selon nos souhaits. La troisième est le désir de ne pas devenir, de ne pas exister en tant que ceci ou cela. En réalité, il n’y a que ces trois formes de désir. Je défie quiconque de trouver un désir qui n’entre pas dans l’une de ces trois catégories.
Nous pouvons tous constater que, là où il y a désir, il y a souffrance : quand nous sommes poussés à agir sur l’impulsion d’un désir, nous souffrons immanquablement en proportion de l’action entreprise et puis, ayant obtenu un résultat, nous sommes incapables de mettre fin à notre désir et nous poursuivons notre quête. La raison pour laquelle nous sommes forcés de continuer à souffrir, c’est que nous ne sommes pas encore libérés du désir, nous en sommes les esclaves. Ainsi un méchant homme fait du mal parce qu’il désire faire du mal et souffre ensuite proportionnellement à sa méchanceté ; de la même manière, un homme bon désire faire du bien et souffre d’un autre type de souffrance, proportionnellement à sa bonté. Attention, n’allez pas croire qu’il ne faut pas faire le bien ! Cet enseignement nous montre simplement qu’il existe des degrés de souffrance très subtils, imperceptibles à l’individu moyen. Nous devons suivre les conseils du Bouddha : si nous voulons nous libérer complètement de la souffrance, faire du bien ne suffit pas. Il est indispensable d’accomplir des choses qui vont plus loin, au-delà des bonnes actions ; des choses qui permettront de libérer l’esprit de sa condition d’asservissement aux désirs de toutes sortes. Telle est la quintessence de l’enseignement du Bouddha et nous devons bien nous en souvenir. Réussir à nous affranchir de ces trois formes de désir, c’est atteindre la libération complète de la souffrance.
Comment pouvons-nous éliminer la soif du désir, l’éradiquer et y mettre fin pour de bon ? La réponse est simple : observer et prendre note de l’impermanence, l’insatisfaction (ou souffrance) et le non-soi, jusqu’à voir clairement que rien de vaut la peine d’être désiré. Qu’y a-t-il qui vaille la peine d’avoir ou d’être ? Qu’y a-t-il qui n’engendre pas une forme de souffrance une fois obtenu ? Posez-vous cette question : qu’y a-t-il que vous puissiez obtenir ou devenir sans entraîner détresse ou angoisse ? Pensez-y bien. Le fait d’avoir une femme et des enfants engendre-t-il la gaieté de cœur et la liberté ou, au contraire, toutes sortes de responsabilités ? Le fait d’avoir obtenu une haute position sociale vous donne-t-il automatiquement la paix et le calme ou, au contraire, de lourdes obligations ? Quand on considère les choses sous cet angle, on se rend vite compte que tout cela n’apporte que fardeau et responsabilité. Pourquoi ? Tout, absolument tout, est fardeau, du simple fait des caractéristiques d’impermanence, d’insatisfaction et de non-soi. Une fois que nous avons obtenu une certaine chose, nous devons veiller à la garder, nous assurer qu’elle est bien comme nous le voulons ou qu’elle nous est profitable. Mais cette chose, de par sa nature, est impermanente, insatisfaisante et n’appartient à personne. Elle ne peut se conformer à nos objectifs et à nos desseins personnels ; elle ne peut que changer en fonction de sa nature. Tous nos efforts ne sont alors qu’une tentative de nous opposer et de résister à la loi du changement ; or la vie, vécue comme une tentative de faire se conformer les choses à nos souhaits, est pleine de difficultés et de souffrances.
Il existe une technique pour prendre conscience que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Elle consiste à examiner les choses assez profondément pour découvrir que, en présence de la convoitise, nous sommes attirés par l’idée d’avoir ou d’être, tandis que, lorsque le désir a cédé la place à la vision pénétrante de la véritable nature des choses, notre attitude est tout à fait différente. Prenons un exemple facile : la nourriture. Un homme qui mange avec avidité et recherche les saveurs délicieuses se distingue, par certains traits, de celui qui mange sans désir mais avec la compréhension claire ou vision pénétrante de la véritable nature des choses. Leur façon de manger est nécessairement différente, leurs sensations quand ils mangent sont nécessairement différentes, et il en va de même pour les résultats engendrés par le fait de manger.
Ce qu’il faut comprendre, à présent, c’est que l’on peut se nourrir même si on a perdu tout désir pour les saveurs délicieuses. Le Bouddha et les Arahants, qui étaient libérés du désir, étaient tout de même capables de faire des choses et d’être ; ils effectuaient leurs tâches et en faisaient bien plus qu’aucun d’entre nous avec tous nos désirs. En vertu de quel pouvoir pouvaient-ils faire cela – autrement dit, à quoi correspondait chez eux la force de la convoitise et du désir d’être ceci ou cela, qui nous pousse à agir ? La réponse est qu’ils agissaient en vertu du pouvoir de la vision pénétrante, la connaissance claire et profonde de « ce qui est » ou véritable nature des choses. Ils ne désiraient rien obtenir ou posséder pour eux-mêmes, et leur bienveillance et leur sagesse ont profité aux autres. C’est ainsi qu’ils ont pu transmettre leurs enseignements.
Etre libéré de la convoitise a de nombreux à-côtés positifs. Un corps et un esprit libérés de la convoitise peuvent rechercher la nourriture et manger en étant motivés par un discernement intelligent et non, comme avant, par le désir. Si nous voulons nous libérer de la souffrance en suivant les traces du Bouddha et des Arahants, nous devons nous exercer à agir avec discernement plutôt qu’avec convoitise. Si vous êtes étudiant, apprenez à distinguer le bien du mal et vérifiez qu’étudier est ce que vous avez de mieux à faire. Si vous avez un travail, apprenez à distinguer le bien du mal, assurez-vous que ce travail est ce que pouvez faire de mieux et qu’il bénéficie à toutes les personnes concernées. Ensuite, faites-le bien, avec tout le détachement et la sérénité que votre vision pénétrante peut procurer. Si nous faisons quelque chose en étant motivés par le désir, nous sommes inquiets en le faisant et inquiets quand c’est fini ; tandis que, si nous nous laissons guider par le discernement, nous ne sommes pas inquiets du tout. Voilà la différence.
Il est donc essentiel que nous soyons toujours conscients qu’en réalité tout est impermanent, insatisfaisant et dépourvu de soi, c’est-à-dire que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Si nous devons nous engager dans ce monde, faisons-le avec discernement ; ainsi nos actions ne seront pas contaminées par le désir. Si nous agissons avec sagesse, nous serons libérés de la souffrance, du début à la fin. L’esprit ne cherchera pas aveuglément à se saisir des choses et à se les approprier comme si elles en valaient la peine. Nous serons assurés d’agir la conscience en éveil mais également en mesure de vivre selon la tradition, les coutumes ou les lois. Par exemple, même si nous possédons des terres, nous ne sommes pas obligés d’avoir un comportement possessif ; il est inutile de nous y attacher au point qu’elles nous deviennent un fardeau pesant qui nous tourmente l’esprit. La loi a pour mission de veiller à ce que ces terres restent en notre possession ; alors inutile de nous angoisser, elles ne vont pas nous glisser entre les doigts et disparaître. Même si quelqu’un venait nous les prendre, nous pourrions certainement nous y opposer et les protéger intelligemment. Nous pouvons résister sans colère, sans nous laisser brûler par les flammes de la haine. Nous pouvons nous appuyer sur la loi et opposer notre propre résistance, sans qu’il soit nécessaire de souffrir. Bien sûr que nous devons veiller à notre propriété, mais si vraiment elle devait nous être arrachée, il ne servirait à rien de nous laisser aller à de grandes émotions. Tout est impermanent, en perpétuel changement. Lorsque nous comprenons bien cela, nous n’avons plus besoin de nous inquiéter de rien.
Il en est de même pour « être ». Il est inutile de s’attacher à notre état d’être ceci ou cela parce qu’en réalité il n’existe aucun état satisfaisant. Toutes les circonstances sont chargées, en puissance, d’une forme de souffrance ou d’une autre. Il y a une technique très simple que nous étudierons plus tard qui s’appelle vipassanā et qui est la pratique directe du Dhamma. C’est une introspection très fine qui révèle qu’il n’y a rien qui vaille la peine d’être ou qu’il n’y a réellement aucun état d’être satisfaisant. Considérez vous-mêmes cette question, voyez si vous pouvez trouver ne serait-ce qu’une situation ou un état d’être satisfaisant : être fils ? Parent ? Mari ? Épouse ? Patron ? Employé ? Y en a-t-il un qui soit agréable ? Même être dans une situation avantageuse, être celui qui a la main haute sur les autres, le gagnant – est-ce agréable ? La condition d’être humain est-elle agréable ? Et même la condition d’être céleste ou de dieu, serait-elle agréable ? Lorsque vous avez vraiment compris « ce qui est », vous découvrez qu’absolument rien n’est agréable. Nous trouvons une satisfaction aveugle à avoir et à être, mais pourquoi continuer à risquer notre vie à agir inconsidérément sur l’impulsion du désir ? Il nous faut comprendre les choses et vivre avec sagesse, ne nous engageant dans la vie que de manière à causer un minimum de souffrance ou, mieux encore, aucune.
Et maintenant venons-en à un autre point important : nous devons faire savoir à ceux qui nous entourent, à nos amis, et en particulier à notre famille et à nos proches, quelle est la véritable nature des choses, de sorte qu’ils adoptent la même vue juste que nous. Ainsi il n’y aura pas de bouleversements dans la famille, dans la ville, dans le pays et, en fin de compte, dans le monde. L’esprit de chaque individu sera immunisé contre le désir, il ne cherchera pas à s’approprier ou à s’attacher des objets ou des personnes. Au contraire, la vie sera guidée par la vision pénétrante, par la vision toujours présente et claire qu’il n’y a, en réalité, rien que nous puissions nous approprier et nous attacher. Tout le monde parviendra à réaliser que tout, en ce monde, est impermanent, insatisfaisant et dépourvu d’un soi et, en conséquence, que rien ne justifie que l’on se laisse happer dans le cercle vicieux. C’est à nous d’avoir le bon sens de lâcher prise, d’adopter une vision juste, en rapport avec les enseignements du Bouddha. Celui qui agit ainsi mérite d’être appelé un vrai bouddhiste. Même s’il ne devient jamais moine et ne prend pas même les préceptes, il aura pénétré vraiment le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Son esprit sera identique à celui du Bouddha, du Dhamma et du Sangha : immaculé, éveillé et paisible en vertu du non attachement à des choses qu’il ne considère plus comme valant la peine d’avoir ou d’être. Ainsi il est possible de devenir un authentique bouddhiste à part entière, simplement grâce à cette technique qui consiste à observer, à percevoir l’impermanence, l’insatisfaction et le non-soi, jusqu’à réaliser que rien ne vaut la peine d’avoir ou d’être quoi que ce soit.
Les formes les plus viles du mal prennent naissance et sont renforcées par le désir d’avoir ou d’être quelque chose ; des formes moins virulentes du mal sont engendrées par des actions moins fortement motivées par le désir ; et toutes les formes du bien proviennent d’actions basées sur une forme de désir très subtil, très raffiné, un désir d’être ou d’avoir à un niveau positif. Même dans ses formes les plus élevées, le bien est basé sur le désir mais un désir si ténu que les gens ne le considèrent pas comme mauvais. Il n’en reste pas moins qu’une bonne action n’apportera jamais la libération de la souffrance. Celui qui s’est totalement libéré du désir, l’Arahant, a cessé d’agir sur l’impulsion du désir, il est devenu incapable de faire le mal ; ses actions se situent au-delà des catégories du bien et du mal ; il est ainsi complètement libéré de la souffrance.
Ceci est un des principes fondamentaux du bouddhisme. Que nous soyons capables de l’appliquer ou non, que nous le voulions ou non, telle est la voie de la libération de la souffrance. Il se peut qu’aujourd’hui vous n’en vouliez pas mais, un jour ou l’autre, inévitablement, vous y viendrez. Lorsque nous avons complètement abandonné le mal et que nous avons fait tout le bien que nous pouvions, l’esprit demeure embourbé dans toutes sortes de désirs flous, et il n’existe aucun moyen de s’en débarrasser, sinon s’efforcer d’aller au-delà du désir d’avoir ou d’être quoi que ce soit, bon ou mauvais. Pour que vienne le Nirvana, la libération de la souffrance sous toutes ses formes, il doit y avoir une absence totale et absolue de désir.
En résumé, savoir « ce qui est » au sens ultime du terme, c’est voir partout l’impermanence, l’insatisfaction et l’absence de soi. Lorsque nous sommes réellement persuadés de cela, l’esprit parvient à voir les choses de telle manière qu’il ne s’y cramponne plus. Alors, si nous devons nous engager dans le monde en « ayant » et en « étant » quelque chose, nous pouvons le faire intelligemment, motivés par la vision pénétrante et non par le désir. En agissant ainsi nous demeurons libres de toute souffrance.
Chapitre VI
CONVOITISE ET ATTACHEMENT
Comment pouvons-nous échapper aux choses et en devenir complètement indépendants, libres de ces choses qui sont toutes passagères, insatisfaisantes et dénuées de soi ? La réponse est que nous devons découvrir la cause de nos désirs et de notre attachement à ces choses. En connaissant la cause, nous serons à même d’éliminer complètement son effet : la convoitise. Les bouddhistes reconnaissent l’existence de quatre formes de convoitise ou attachement :
1) L’attachement sensoriel (kāmūpādāna)
Il se réfère aux objets des sens attirants et désirables. C’est l’attachement que nous éprouvons tout naturellement pour les choses que nous aimons et qui nous donnent satisfaction : couleurs, formes, sons, odeurs, saveurs, objets tactiles ou images mentales – objets passés, présents ou futurs qui viennent à l’esprit et correspondent à des objets du monde matériel, du corps ou de l’imagination. D’instinct nous éprouvons du plaisir, nous nous délectons au contact de ces objets des sens. Ils font les délices de l’esprit qui les perçoit.
Dès sa naissance, un individu apprend à connaître le goût des six objets des sens et à s’y attacher ; au fil des années il s’y attache de plus en plus. La majorité des gens est incapable d’y échapper, c’est un sérieux problème. Il est indispensable d’avoir une connaissance et une compréhension de ces objets des sens, et d’agir en conséquence, faute de quoi l’attachement risque d’entraîner une dérive absolue. Si nous étudions le cas de toute personne ayant sombré à la dérive, nous découvrons immanquablement qu’il y avait, à l’origine, un fort attachement à un objet désirable à ses sens. En fait, tout ce que font les humains est lié aux sens. Qu’ils aiment, se mettent en colère, détestent, jalousent, tuent ou se suicident, la cause ultime est inévitablement un objet des sens. Si nous allons voir de près pourquoi les êtres humains travaillent ou s’activent à toutes sortes de choses avec énergie, nous constatons que, ce qui les pousse, c’est le désir, le désir d’obtenir quelque chose, quelle qu’en soit la nature. Les gens font des efforts, étudient et gagnent tout l’argent qu’ils peuvent, puis s’en vont à la recherche du plaisir sous forme de couleurs et de formes, de sons et d’odeurs, de saveurs et d’objets tactiles. C’est ce qui les fait avancer. Même accomplir des actions méritoires pour aller au paradis n’est qu’une forme de désir sensuel. Tous les problèmes et les désordres de ce monde ont une seule et même source : la recherche aveugle du plaisir des sens.
Le danger réside dans la force de l’attachement aux sens. C’est pour cette raison que le Bouddha considérait la soif de plaisirs sensoriels comme la forme première de l’attachement. C’est vraiment un problème à l’échelle mondiale. Ce qui adviendra au monde, à l’avenir, sa destruction ou sa rédemption, dépend précisément de cet attachement aux sens. Il est de notre devoir d’étudier comment et dans quelle mesure nous sommes attachés aux sens, et s’il est en notre pouvoir d’abandonner cet attachement.
Selon les critères du monde, l’attachement à la sensualité est une très bonne chose qui engendre amour familial, efficacité et énergie dans la quête de la fortune, de la gloire, etc. Mais, du point de vue spirituel, il est évident que c’est la porte secrète qui ouvre sur la souffrance et le tourment. Spirituellement parlant, l’attachement à la sensualité doit être tenu sous contrôle et, si toute souffrance doit disparaître un jour, l’attachement aux sens devra disparaître complètement.
2) L’attachement aux opinions (ditthūpādāna)
Un minimum d’introspection permet aisément de détecter et d’identifier notre attachement à nos points de vue et à nos opinions. Depuis notre naissance, nous avons reçu une certaine éducation, une formation qui a engendré des idées et des opinions. J’appelle « opinions » ces idées auxquelles on tient et que l’on refuse d’abandonner. S’en tenir à son point de vue est, somme toute, assez naturel et, en général, nul ne condamne ou ne critique une telle attitude. Pourtant, elle représente un danger aussi grave que l’attachement aux objets des sens. Il arrive, n’est-ce pas, que des idées préconçues, auxquelles nous nous cramponnions obstinément, soient balayées par les événements. Il faut donc régulièrement faire évoluer notre façon de voir, l’améliorer progressivement, l’élever, passant ainsi d’une opinion erronée à un point de vue qui se rapproche de plus en plus de la vérité, pour aboutir enfin à inclure dans nos idées les Quatre Noble Vérités.
Il y a plusieurs causes à l’entêtement dans ses opinions mais ce comportement est principalement lié aux coutumes, aux traditions, aux cérémonies et aux doctrines religieuses. Les convictions personnelles ne sont pas très importantes et sont certainement moins nombreuses que celles qui proviennent de lointaines traditions et cérémonies populaires. Adhérer à un point de vue ou un autre est une forme d’ignorance. Ne possédant pas la connaissance, nous développons nos opinions personnelles en les basant sur notre propre ignorance. Nous sommes convaincus, par exemple, que les choses sont désirables et valent la peine que l’on s’y attache, qu’elles peuvent durer, qu’elles ont de la valeur et existent par elles-mêmes, alors qu’en réalité elles sont illusoires, trompeuses, changeantes, sans valeur et sans existence propre. Lorsque nous nous sommes fait une idée sur quelque chose, il ne nous est bien sûr pas agréable d’admettre ensuite que nous nous sommes trompés, même si nous constatons parfois que nous avons fait erreur. C’est cette obstination qui fait terriblement obstacle au progrès et nous rend incapables d’évoluer, incapables de modifier nos fausses convictions religieuses et autres vieilles croyances. Cela risque de poser un problème aux gens qui s’en tiennent à des doctrines naïves car, même s’ils s’aperçoivent un jour qu’elles sont naïves, ils refuseront d’en changer sous prétexte que leurs parents, leurs grands-parents et leurs ancêtres y étaient fidèles. Ou bien, s’ils ne tiennent pas vraiment à se corriger et à s’améliorer, ils se contenteront de repousser les arguments à l’encontre de leurs vieilles idées, en répondant que c’est ce à quoi ils ont toujours cru. Pour toutes ces raisons, l’attachement aux opinions doit être considéré comme un poison mortel, un danger majeur que nous devons, si nous souhaitons vraiment nous améliorer, employer toutes nos forces à éliminer.
3) L’attachement aux rites et rituels (sīlabbatūpādāna)
C’est l’attachement à des pratiques traditionnelles dépourvues de sens qui se sont transmises sans raison, pratiques que les gens décident de considérer comme sacrées et refusent de changer à tout prix. Il y en a en Thaïlande, comme partout ailleurs : croyances concernant des amulettes, des objets magiques et toutes sortes de pratiques secrètes. On croit, par exemple qu’en sortant du sommeil, il faut prononcer une formule mystique au-dessus d’une bassine d’eau puis se laver le visage avec cette eau ; on croit qu’avant de se soulager il faut tourner la tête dans telle ou telle direction ; ou encore qu’avant de manger ou de se coucher il faut pratiquer certains rituels. On croit en l’existence d’esprits, d’êtres célestes, d’arbres sacrés et de toutes sortes d’objets magiques. Tout cela est complètement irrationnel. Les gens ne pensent pas de façon rationnelle, ils se contentent de se cramponner à un schéma préétabli : puisqu’ils se sont toujours comportés ainsi, ils refusent de changer. Beaucoup de gens, qui se prétendent bouddhistes, s’attachent aussi à ces croyances et jouent ainsi sur les deux tableaux ! On trouve même parmi eux des gens qui se prétendent bhikkhus, disciples du Bouddha.
La raison pour laquelle nous devons nous libérer de ces idées est que, si nous pratiquons le Dhamma sans avoir conscience de son objectif original, de sa raison d’être, inévitablement nous le considérons naïvement comme une autre de ces pratiques magiques. Nous voyons ainsi des gens prendre les préceptes ou pratiquer le Dhamma, uniquement pour se conformer au schéma en vigueur, à la cérémonie traditionnelle, pour suivre l’exemple qu’on leur a transmis. Ils ne savent rien du pourquoi et ne font les choses que par habitude. Une telle attitude est difficile à combattre. C’est ce que nous appelons « attachement insensé aux pratiques traditionnelles ». La méditation de la vision pénétrante ou méditation de la tranquillité, telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, risque fort, si elle est faite sans rime ni raison et sans connaissance, d’être motivée par la convoitise et l’attachement, d’être mal dirigée, et donc de n’être qu’une autre forme d’ignorance. Même chose pour la prise des préceptes, que ce soit cinq, huit, dix ou plus : s’ils sont pris dans l’espoir de devenir un saint aux pouvoirs magiques, surnaturels, psychiques ou autres, cela devient un rite mal compris, uniquement motivé par l’attachement aux coutumes et aux rituels.
Il nous faut donc être très prudents. La pratique du bouddhisme doit avoir une base solide dans la pensée, la compréhension et le désir de détruire les pollutions qui obscurcissent l’esprit. Sinon elle ne sera qu’une action mal dirigée et irrationnelle, une perte de temps.
4) L’attachement à l’idée d’un soi (attavādūpādāna)
Cette croyance en un soi personnel est très importante et aussi très subtile. Toutes les créatures vivantes ne peuvent qu’avoir une fausse notion du « moi » et du « mien » ; c’est l’instinct originel de tout de qui vit et la base de tous les autres instincts. Ainsi, l’instinct qui consiste à rechercher de la nourriture et la manger, l’instinct d’éviter le danger, de procréer, et beaucoup d’autres, proviennent du fait que toute créature a une conscience instinctive d’exister et croit être une entité séparée, un « soi ». Convaincue de cela, elle désire naturellement éviter la mort, rechercher la nourriture pour en nourrir son corps, s’abriter du danger, et multiplier son espèce. Nous voyons qu’une telle croyance est universellement répandue chez tous les êtres vivants ; s’il en allait autrement, ils ne pourraient pas survivre. Pourtant, cette même croyance est également la cause de la souffrance qui est inhérente à la recherche de la nourriture et de la protection d’un abri, à la propagation de l’espèce et à toute activité quelle qu’elle soit. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Bouddha a enseigné que l’attachement à l’idée d’un soi est la racine de toute souffrance. Il résuma cela en quelques mots : « Les choses, si nous nous y attachons, sont souffrance ou source de souffrance ». Cet attachement est la source et la base de la vie, et il est en même temps la source et la base de la souffrance sous toutes ses formes. C’est précisément à cela que le Bouddha faisait allusion quand il a dit que la vie est souffrance et que la souffrance est la vie. Cela signifie que le corps et l’esprit (les cinq « agrégats ») auxquels nous nous attachons sont souffrance. Connaître la source et la base de la vie et de la souffrance est considéré comme la connaissance la plus profonde et la plus pénétrante puisqu’elle nous permet d’éliminer radicalement la souffrance.
La façon la plus efficace de se débarrasser de l’attachement est de le reconnaître à chaque fois qu’il se présente. Ceci est surtout valable pour l’attachement à l’idée d’un soi qui est la base même de la vie. C’est quelque chose qui apparaît spontanément et s’installe en nous sans qu’on ait à nous l’inculquer. Il est présent d’instinct chez l’enfant comme chez les petits des animaux, dès la naissance. Regardez comme les chatons prennent une attitude défensive dès qu’on les approche ! Il y a toujours présent à l’esprit ce « quelque chose », ce « moi », et un attachement se manifeste inévitablement. La seule chose à faire est de lui tenir les rênes jusqu’à ce que vous ayez bien avancé dans la connaissance spirituelle ; en d’autres termes, utilisez les principes du bouddhisme jusqu’à ce que cet instinct soit dominé puis complètement éradiqué. Sans cela, une personne ordinaire de ce monde ne peut pas dépasser cet instinct. Seuls les plus élevés des ariyans, les Arahants, réussissent à l’éliminer. Nous devons reconnaître cet obstacle comme étant de première importance pour toutes les créatures vivantes. Si nous voulons bénéficier pleinement de l’enseignement du Bouddha, il nous revient de dépasser cette conception erronée. La souffrance à laquelle nous sommes soumis diminuera en fonction de nos efforts dans ce sens.
Connaître la vérité sur ces choses qui font notre vie quotidienne doit être considéré comme un immense cadeau, un des plus grands dons. Réfléchissez bien à ces quatre attachements, sans jamais oublier que rien, absolument rien ne vaut la peine que l’on s’y attache ; que, de par la nature des choses, rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Si nous sommes complètement asservis par les choses, c’est tout simplement du fait de ces quatre formes d’attachement. Il est important que nous étudiions de près la nature extrêmement dangereuse des choses et que nous nous familiarisions avec elle. Le problème est que cette nature malfaisante ne saute pas immédiatement aux yeux comme celle d’un incendie, d’une arme ou d’un poison ; au contraire, les choses de la vie semblent douces, pleines de saveur, attirantes, belles ou mélodieuses, c’est pourquoi il est difficile de les reconnaître et d’agir correctement. Nous devons, pour cela, utiliser la connaissance que nous a transmise le Bouddha : contrôler notre attachement instinctif et le remplacer par le pouvoir de la vision pénétrante. Nous serons ainsi en mesure d’organiser notre vie de façon à nous libérer de la souffrance, de toute trace de souffrance. Nous pourrons travailler et vivre paisiblement dans le monde, échapper aux pollutions mentales, être éclairés et sereins.
En résumé, ces quatre formes d’attachement sont le seul problème que les bouddhistes ou ceux qui s’intéressent au bouddhisme doivent comprendre. Le but de la vie monastique bouddhiste (brahmacariya) est de permettre à l’esprit d’abandonner sa convoitise instinctive. Vous retrouverez cet enseignement dans tous les textes qui traitent des étapes menant à l’état d’Arahant ; l’expression utilisée est « libre de tout attachement » : c’est l’ultime étape. Quand l’esprit est libre des attachements, plus rien ne peut le retenir et l’asservir au monde. Rien ne peut continuer à le faire tourner encore et encore dans le cycle des naissances et des morts, de sorte que le processus s’arrête ou plutôt, transcende le monde, s’en libère. L’abandon de l’attachement instinctif est donc la clé de la pratique du bouddhisme.
Chapitre V
LE TRIPLE APPRENTISSAGE
Dans ce chapitre, nous étudierons la technique qui permet d’éliminer l’attachement. Cette technique s’appuie sur trois éléments concrets – la vertu, la concentration et la vision pénétrante – connus sous le nom de « triple apprentissage ».
Le premier élément est la vertu (sīla). Etre vertueux signifie simplement avoir une attitude correcte, conforme aux normes en vigueur et ne causant aucune souffrance à autrui ou à soi. La vertu (ou comportement moral) peut être codifiée sous forme de « préceptes » – les cinq, huit, dix ou deux-cent-vingt-sept préceptes – ou autrement. Elle concerne la parole et l’action qui doivent s’appliquer à apporter la paix, le bien-être et la libération de tout ce qui peut être indésirable, au niveau le plus simple. Elle se réfère aux membres d’un groupe social et aux différentes possessions nécessaires à la vie.
Le second aspect du triple apprentissage est la concentration (samādhi). Celle-ci consiste à forcer l’esprit à se maintenir dans l’état le plus favorable possible pour atteindre son objectif. Qu’est-ce, au juste, que la concentration ? En général, les gens pensent que la concentration engendre automatiquement un esprit tranquille et aussi immobile qu’une bûche. Mais ces deux attributs, tranquillité et stabilité, ne suffisent pas à expliquer le sens réel de la concentration. La meilleure définition en a été donnée par le Bouddha, qui décrivit l’esprit concentré comme étant « apte au travail » (karanīya), c’est-à-dire dans la condition appropriée pour accomplir sa tâche.
Le troisième aspect est l’apprentissage de la vision pénétrante qui développe la sagesse (paññā). Il s’agit d’une pratique assidue qui permet d’éveiller la compréhension juste et la perception intérieure claire de la véritable nature des choses. En temps normal, nous en sommes incapables : soit nous nous en tenons à des idées préconçues, soit nous répétons ce que disent les autres, de sorte que nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont réellement. C’est pourquoi la pratique du bouddhisme inclut cet apprentissage de la vision pénétrante.
Dans le contexte religieux, la compréhension et la vision pénétrante sont deux choses très différentes. La compréhension est, en grande partie, basée sur l’usage du raisonnement intellectuel. La vision pénétrante va bien plus loin : elle absorbe l’objet de son observation après l’avoir pénétré et étudié directement ; l’esprit voit alors s’éveiller un détachement profondément authentique vis-à-vis de cet objet, coupant toute émotion envers lui. Dans le contexte du bouddhisme, l’apprentissage de la vision pénétrante ne repose donc pas sur une compréhension intellectuelle telle qu’on la trouve aujourd’hui dans les milieux académiques où chacun peut détenir sa propre vérité. La vision pénétrante doit être intuitive, claire et immédiate ; elle résulte d’une investigation si profonde de l’objet qu’elle marquera l’esprit de manière indélébile. C’est pourquoi les objets d’étude de la vision pénétrante doivent être de ceux que l’on rencontre dans la vie de tous les jours, ou du moins être assez importants pour en saturer réellement l’esprit qui les verra enfin tels qu’ils sont, c’est-à-dire impermanents, insatisfaisants et sans réalité propre. Nous avons beau réfléchir et étudier les caractéristiques de l’impermanence, de l’insatisfaction et de l’absence d’un moi personnel, nous n’en retirerons rien de plus qu’une compréhension intellectuelle, laquelle sera incapable de détruire la convoitise et l’attachement aux choses de ce monde. Or la vision pénétrante se manifeste lorsque le désenchantement remplace l’attirance possessive. C’est un fait naturel que la vision pénétrante, claire et authentique, entraîne automatiquement un réel détachement. Mais le processus ne s’arrête pas à une perception claire ; il continue jusqu’au moment où le désenchantement remplace irrévocablement le désir.
L’apprentissage de la vertu n’est qu’une préparation de base qui nous permet de vivre heureux et nous aide à stabiliser l’esprit. Elle offre de nombreux avantages – elle peut mener au bonheur ou à une prochaine vie en tant qu’être céleste – mais, selon le Bouddha, ce ne doit pas être là son objectif immédiat. Avant tout, en libérant l’esprit, elle ouvre la voie à la concentration.
L’apprentissage de la concentration consiste à développer notre capacité à contrôler l’esprit pour lui faire accomplir sa tâche au mieux. Tandis que la vertu développe l’attitude juste par rapport à l’action et à la parole, la concentration s’adresse à l’esprit. Elle est le fruit d’un travail et d’une discipline spirituelle approfondis. L’esprit concentré est libre de toute pensée mauvaise ou erronée, et ne s’éloigne jamais de l’objet de sa concentration. Il est ainsi en mesure de bien faire son travail.
De fait, la concentration est nécessaire à toutes les situations de la vie. Quoi que nous entreprenions, l’esprit doit être concentré pour le mener à bien. C’est pourquoi le Bouddha considérait la concentration comme la caractéristique d’un être noble, que ce soit dans le monde matériel ou le monde spirituel. L’écolier qui étudie l’arithmétique utilise ce que l’on appelle « la concentration naturelle » – d’ailleurs souvent peu développée ! Quant à la concentration dont nous parlons ici, en tant que pratique du bouddhisme, elle est le fruit d’un entraînement assidu, et atteint des sommets bien supérieurs. Lorsque l’esprit a été correctement entraîné, il obtient de nombreux pouvoirs et la personne avance dans sa connaissance des secrets de la nature. Savoir contrôler l’esprit apporte des capacités ignorées du commun des mortels. Le Bouddha lui-même, considérait la concentration profonde comme un pouvoir surhumain – dont les moines ne devaient d’ailleurs jamais se vanter, sous peine d’être déchus.
Atteindre la concentration nécessite des sacrifices. Nous devons faire face à toutes sortes de difficultés dans la pratique, jusqu’au moment où nous atteignons le degré de concentration en rapport avec nos capacités. Parallèlement, par contre, nous obtenons de bien meilleurs résultats dans notre travail, du simple fait que nous disposons de meilleurs outils.
Alors, penchez-vous sur cette question de la concentration, ne la croyez pas ridicule ou démodée. Elle est, au contraire, extrêmement importante et peut s’utiliser à tout moment, en particulier dans le monde d’aujourd’hui qui semble tourner trop vite et être prêt à se consumer. La concentration est certainement encore plus nécessaire de nos jours qu’elle ne l’était au temps du Bouddha.
Voyons maintenant comment se fait le passage de l’apprentissage de la concentration à l’apprentissage de la vision pénétrante. Le Bouddha a dit un jour que, lorsque l’esprit est concentré, il est en mesure de voir les choses telles qu’elles sont réellement. Quand l’esprit est concentré et apte au travail, il connaît la véritable nature des choses. Il est drôle de constater que la réponse à toutes les questions que se posent les gens est généralement déjà présente dans leur esprit mais ils ne s’en rendent pas compte car cela se passe au niveau de leur subconscient. Tant qu’ils essaieront de résoudre leurs problèmes sans mettre leur esprit dans les conditions favorables, la solution leur échappera. Si, au contraire, pour répondre à une question d’ordre mental, une personne développe la concentration juste et la vision pénétrante, c’est-à-dire si elle fait en sorte que son esprit soit « apte au travail », la réponse se présentera d’elle-même. Et si cette tactique échoue, il existe encore une autre méthode pour diriger l’esprit vers la résolution du problème ; il s’agit de l’introspection concentrée ou « apprentissage de la vision pénétrante ».
Le jour de son Eveil, le Bouddha a atteint la vision pénétrante de la loi des causes et effets. Cela signifie que, grâce à sa concentration, il a perçu la véritable nature des choses et l’ordre dans lequel elles se déroulent. Le Bouddha a fait le récit détaillé de cet événement mais on peut le résumer ainsi : dès que son esprit fut bien concentré, il fut à même d’élucider la question.
Ce n’est que lorsque l’esprit est paisible et détaché, dans un état de bien-être, frais et concentré, que la solution à un problème récurrent se présente. La vision pénétrante dépend toujours de la concentration, même si nous ne l’avons jamais remarqué. Le Bouddha insiste sur le lien très étroit qui existe entre les deux, en montrant que la concentration est indispensable à la vision pénétrante, et la vision pénétrante indispensable à la concentration, à un certain niveau de profondeur, car cela nécessite la compréhension de certaines caractéristiques de l’esprit. En effet, il faut savoir dans quelle mesure exacte l’esprit doit être contrôlé pour lui permettre d’atteindre la concentration. Donc, plus une personne est capable de vision pénétrante, plus sa concentration pourra s’approfondir et, à son tour, l’approfondissement de la concentration mènera à l’approfondissement de la vision pénétrante. Les deux se renforcent mutuellement.
La vision pénétrante sous-entend un regard sans complaisance, lequel conduit inévitablement au désintérêt et à l’ennui. Il en résulte un recul vis-à-vis de toutes ces choses qui nous attiraient si fort auparavant ; un détachement sur le plan mental, qui a pour conséquence de libérer l’esprit de l’esclavage des choses. C’est ce qui arrive lorsque le désir cède le pas au détachement. Il ne s’agit donc pas d’aller se suicider, de se retirer comme un ermite dans la forêt, ou de mettre le feu à tout. En apparence, rien n’est changé, on se comporte normalement et on respecte les choses. La différence est à l’intérieur : l’esprit est indépendant et libre. Telle est la vertu de la vision pénétrante. Le Bouddha a appelé cela « la délivrance », la fin de l’esclavage des choses et, en particulier, de celles que nous aimons. En réalité, nous sommes également esclaves de celles que nous n’aimons pas – esclaves dans le sens où nous ne pouvons pas nous empêcher de ne pas les aimer, parce qu’elles nous font réagir, activent nos émotions et parviennent ainsi à nous mener par le bout du nez, tout autant que les choses que nous désirons ardemment. L’expression « esclave des choses » se réfère donc aux réactions d’attraction comme de répulsion. Ceci pour en revenir au fait que nous pouvons échapper à l’esclavage des choses et devenir libres grâce à la pratique de la vision pénétrante. Le Bouddha résuma ce principe en quelques mots : « La vision pénétrante est le moyen qui nous permet de nous purifier ». Pas la vertu ou la concentration mais la vision pénétrante. Si l’on n’est pas libéré des choses, on est impur, pollué, prétentieux, passionné. Une fois libre, on est pur, immaculé, éveillé et en paix. C’est le fruit de la sagesse lorsqu’elle a achevé son œuvre.
Observez bien cet élément, la sagesse, troisième aspect du Triple Apprentissage. Apprenez à le connaître et vous en viendrez rapidement à le considérer comme la plus grande des vertus. La sagesse conduit à un recul par rapport aux choses, en détruisant complètement les quatre formes d’attachement (objets des sens, opinions, habitudes et idée d’un « moi »). Celles-ci sont comme des cordes serrées qui nous lient tandis que la sagesse est le couteau capable de les couper et de nous libérer.
Ces trois éléments de la pratique résistent-ils au test de la vie ? Ont-ils une base saine et sont-ils utilisables par tous ? Observez-les et vous constaterez qu’ils ne s’opposent à aucune doctrine religieuse – étant bien entendu que la religion en question cherche réellement à résoudre le problème de la souffrance humaine. Les enseignements du Bouddha ne s’opposent à aucune religion mais, par contre, ils apportent certains éléments uniques et, en particulier, la pratique de la vision pénétrante qui est la technique la plus extraordinaire pour réussir à éliminer les quatre formes d’attachement. Elle libère l’esprit, le rend indépendant, plus rien ne peut le lier ou l’étouffer, pas même le dieu du ciel, les esprits ou les êtres célestes. Nous devons être pleinement conscients de ce principe d’autonomie qui est un facteur clé du bouddhisme.
Quand nous voyons que le bouddhisme a tout ce que les autres religions ont, plus certains autres éléments qui lui sont propres, nous comprenons qu’il s’adresse à tous, qu’il est une religion universelle. De tous temps, les êtres ont eu la même préoccupation, qu’il s’agisse des êtres célestes, des humains ou des animaux : se libérer de la souffrance qui est inhérente à la naissance, à la vieillesse, à la douleur et à la mort – souffrance qui naît du désir et de l’attachement. Tous ont la même tâche, qui consiste à éliminer complètement le désir et l’attachement instinctifs, causes premières de la souffrance. C’est pourquoi le bouddhisme est une religion universelle.
Chapitre VI
CE QUI NOUS ATTACHE
A quoi sommes-nous attachés ? Quelle est cette chose à laquelle nous nous agrippons si fort dans la vie ? La réponse à cette question est : « le monde ». Dans le bouddhisme ce mot recouvre tout : non seulement le monde des êtres humains mais aussi celui des êtres célestes, des dieux, des bêtes ou des démons de l’enfer, des fantômes affamés, des titans et de tout autre sphère d’existence.
Il est difficile de connaître ce vaste monde car certains niveaux nous demeurent invisibles ; nous n’en connaissons le plus souvent que la couche superficielle, celle de la vérité relative, qui correspond au niveau moyen de l’intelligence humaine. C’est pour cette raison que le bouddhisme nous instruit sur le « monde » à tous ses niveaux.
Le Bouddha, dans son enseignement, divisait le monde en deux : le monde matériel ou physique, et le monde non matériel ou mental. Il subdivisait ensuite le monde mental en quatre parties, de sorte qu’en y ajoutant le monde physique on arrive à un total de cinq composants que le Bouddha a appelé « les cinq agrégats ». Dans notre étude du monde, nous mettrons l’accent sur le monde des créatures vivantes et de l’être humain en particulier, parce que c’est lui qui pose problème. Ces cinq composants sont tous présents chez l’être humain : son corps physique est l’agrégat matériel, et son esprit peut se diviser selon les quatre autres agrégats suivants.
Le premier des agrégats de l’esprit est la sensation (vedanā), laquelle peut prendre trois aspects : le plaisir ou la satisfaction, le déplaisir ou l’insatisfaction, et une sensation neutre qui n’est ni plaisir ni déplaisir mais qui correspond tout de même à une forme de sensation. En temps normal, les sensations sont toujours présentes en nous ; nous sommes envahis de sensations, c’est pourquoi le bouddhisme les a décrites comme l’une des composantes de l’esprit humain.
La deuxième composante de l’esprit est la perception (saññā), c’est-à-dire le processus qui consiste à prendre conscience de son environnement, un peu comme la différence entre l’état de veille et l’état de sommeil ou de mort. Il fait appel à la mémoire ainsi qu’à la conscience des sensations, et recouvre donc à la fois les sensations primaires résultant du contact d’un objet avec les yeux, les oreilles, le nez, le palais ou le corps, mais aussi le souvenir des contacts sensoriels passés. Il est ainsi possible d’être directement conscient de la couleur, de la taille ou du genre d’un objet, et d’en avoir également conscience avec recul, du fait de la mémoire.
Le troisième agrégat de l’esprit est la pensée active (sankhārā), penser que l’on va faire ou dire quelque chose, bonnes et mauvaises pensées, pensée volontaire, pensée active.
Le quatrième composant est la conscience sensorielle (viññāna). Cette fonction de l’esprit consiste à prendre connaissance des objets perçus par les sens – c’est-à-dire la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le contact du corps – mais aussi par l’esprit lui-même.
Ces quatre agrégats, ainsi que le corps physique, sont le siège des quatre types d’attachement étudiés au chapitre 4. Retournez en arrière et relisez-le jusqu’à bien le comprendre. Vous verrez alors que ces cinq agrégats sont à la fois l’objet et la pierre angulaire de notre attachement et de nos peurs. Selon notre degré d’ignorance, nous pouvons nous identifier à n’importe lequel d’entre eux. Un enfant qui se fait mal en se cognant accidentellement la tête contre une porte, par exemple, se libère de sa colère et de sa douleur en donnant un coup de pied à la porte. Autrement dit, il prend la porte, objet purement matériel, pour une « personne ». Il s’agit là de l’attachement au niveau le plus simple mais, un adulte furieux contre son corps, au point de se frapper ou de se taper sur la tête, fait preuve du même attachement en s’identifiant au corps.
Un homme un peu plus intelligent s’identifiera plutôt à ses sensations, à sa perception des choses, à sa pensée ou à sa conscience sensorielle et, s’il est incapable de distinguer les cinq agrégats les uns des autres, il s’identifiera globalement à l’ensemble.
Après le corps physique, l’aspect auquel nous risquons de nous identifier le plus facilement est la sensation, qu’elle soit agréable, douloureuse ou neutre. Imaginons, par exemple, que nous baignions dans des sensations particulièrement délectables, que nous soyons grisés, cœur et âme, par une délicieuse variété de couleurs et de formes, de sons, de parfums, de saveurs et de contacts. Dans ce cas, la sensation est l’expérience du plaisir, et c’est à cette sensation de plaisir que nous nous attachons. Pratiquement tout le monde s’identifie à ses sensations, pour la simple raison que tout le monde aime les sensations agréables et, en particulier, le toucher, les sensations liées au contact avec la peau. L’ignorance ou l’illusion nous aveugle. Nous voyons seulement l’objet de nos délices et nous nous y attachons en l’appelant « nôtre ». La sensation, qu’elle soit agréable ou désagréable, est véritablement l’un des sièges de la souffrance. Spirituellement parlant, ces sensations sont synonymes de souffrance car elles n’engendrent que le tourment de l’esprit : le plaisir l’agite tandis que le déplaisir l’abat. Gain et perte, bonheur et chagrin, ne se résument finalement qu’à une forme d’agitation de l’esprit, ils lancent la toupie du mental. Voilà ce que signifie l’attachement par identification à la sensation.
Nous aurions tous intérêt à bien étudier et à bien comprendre ce processus. Si l’esprit parvient à considérer la sensation comme un simple objet d’attachement, il s’en affranchira. D’ordinaire, les sensations contrôlent l’esprit, nous entraînent dans des situations que nous regrettons ensuite. Sur la voie pratique que le Bouddha a conçue pour nous mener à la perfection (ou état d’Arahant), il nous incite inlassablement à bien observer, étudier et comprendre le phénomène des sensations. Beaucoup se sont libérés de la souffrance et ont atteint la perfection en faisant des sensations un simple objet d’observation.
La sensation, plus qu’aucun des autres agrégats, risque de servir de base à notre attachement pour la simple raison qu’elle est le but premier de toute notre agitation et de toutes nos actions. Nous étudions avec sérieux et travaillons pour gagner de l’argent avec lequel nous achetons toutes sortes de choses : ustensiles, nourriture, amusements, depuis la gastronomie jusqu’au sexe. Nous profitons de ces choses dans un unique objectif : le plaisir des sens, autrement dit la stimulation agréable de nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre palais et notre corps. Nous investissons toutes nos ressources financières, physiques et mentales dans l’unique perspective de sensations agréables. D’ailleurs, chacun sait, au fond de lui, que jamais il n’investirait tant d’études, de travail et d’énergie s’il n’espérait en retirer un profit sous forme de sensations agréables.
Il est donc bien évident qu’il s’agit là d’un point crucial. Connaître et comprendre l’importance des sensations nous permet d’en garder le contrôle, nous élève au-dessus d’elles, et nous donne la possibilité d’accomplir nos tâches bien plus efficacement.
De la même manière, les problèmes sociaux ont leur origine dans la sensation de plaisir et, lorsqu’on analyse de près les heurts entre nations ou entre blocs opposés, on découvre, là aussi, que les deux côtés sont esclaves de la sensation de plaisir. Les guerres ne naissent pas de la foi en une doctrine, un idéal ou quoi que ce soit, mais de l’anticipation du plaisir sensoriel. De chaque côté, on s’imagine accumulant toutes sortes de gains et de richesses. La doctrine n’est que le camouflage ou, au mieux, une motivation secondaire. La cause la plus profondément ancrée de tout conflit est, en réalité, la soumission au plaisir de la sensation. Connaître la sensation, c’est donc être conscient d’une cause essentielle de notre esclavage aux pollutions de l’esprit, au mal et à la souffrance.
Si telle est la situation dans le monde des humains, sachez que les êtres célestes ne sont pas mieux lotis. Ils sont tout aussi dépendants des sensations de plaisir, et peut-être même plus. Bien qu’ils considèrent cet attrait comme plus raffiné, ils n’en sont pas moins attachés et fascinés par les sensations délectables perçues par les yeux, les oreilles, le nez, le palais, le corps et l’esprit. Au-delà, au niveau des déités, les délices des sens ont forcément été abandonnés mais il existe un autre type de satisfaction cause d’attachement : le plaisir lié à la pratique de la concentration profonde. L’esprit profondément concentré éprouve du plaisir, une sensation délicieuse à laquelle il s’attache. Les animaux, au-dessous des êtres humains, sont inévitablement la proie des sensations, d’une manière plus crue que nous. Connaître la nature des sensations et surtout savoir que nous ne sommes pas la sensation et que nous n’avons aucune raison de nous y attacher ou de nous y identifier, est donc une aide très précieuse dans la vie.
La perception est aussi un aspect de l’esprit auquel il est facile de s’identifier. Les paysans se plaisent à affirmer que, dans notre sommeil, une chose appelée « âme » s’échappe hors du corps, lequel se retrouve alors comme une bûche, incapable de percevoir la moindre stimulation sensorielle. Dès que cette « chose » réintègre le corps, la conscience et l’état d’éveil réapparaissent. Nombreux sont ceux qui, naïvement, assimilent ainsi la perception à un « soi ». Cependant, comme l’a enseigné le Bouddha, percevoir n’implique pas l’existence d’une « personne ». La perception n’est qu’un amalgame de sensations et de souvenirs, c’est-à-dire de connaissances accumulées et elle est inévitablement présente tant que le corps continue à fonctionner normalement. Dès que les fonctions corporelles se dérèglent, cette chose que nous appelons « perception » change ou cesse de fonctionner. C’est la raison pour laquelle les vrais bouddhistes refusent d’assimiler la perception à un « soi » personnel. De fait, une étude fine et profonde selon les critères enseignés par le Bouddha aboutit à un résultat diamétralement opposé : la perception n’implique aucun « soi », elle n’est que le fruit de processus naturels et rien de plus.
Une autre cause d’attachement vient de la pensée active, celle qui projette l’intention de faire ceci ou d’obtenir cela, l’action de l’esprit, qu’elle soit bonne ou mauvaise. La pensée est, elle aussi, la base d’une forte identification à un moi personnel. Les gens vous diront que, s’il faut s’identifier à quelque chose, ce sera en priorité à cet élément penseur. C’est ainsi qu’un philosophe du 18ème siècle a basé ses théories sur le postulat : « Je pense, donc je suis ». Les philosophes de notre époque scientifique n’ont pas évolué sur le sujet : comme depuis des milliers d’années, ils maintiennent que la pensée est le siège du moi personnel ; selon eux, le « moi » est le penseur. Nous avons vu que, pour le Bouddha, ni les sensations ni les perceptions ne constituaient un « moi ». Il a rejeté de même la pensée, l’aspect penseur de l’esprit, en tant que soi, du fait que l’activité qui se manifeste sous forme de pensée est un processus purement naturel. La pensée naît du résultat de l’interaction d’une série d’événements antérieurs. Elle n’est qu’un ensemble d’agrégats, de composants variés qui constituent « l’individu » et ne prouvent aucunement l’existence d’un « je » ou d’un « moi ». En conséquence, nous maintenons que l’élément « pensée » est dénué de toute entité personnelle, au même titre que les agrégats précédemment mentionnés.
Notre difficulté à comprendre cela est due à une méconnaissance de notre esprit. Nous connaissons bien le corps, l’agrégat matériel, mais pratiquement pas l’esprit, l’ensemble des agrégats immatériels. Nous dirons simplement ici que le Bouddha a enseigné que « l’individu » est un ensemble composé de cinq agrégats physiques et mentaux. Lorsque ce que nous appelons une « pensée » se produit, nous concluons trop vite qu’il y a « quelqu’un » derrière, un penseur, une âme qui domine le corps ou quelque chose de ce genre. Mais le Bouddha rejette totalement cette façon de voir. Lorsque l’on décompose le soi-disant « individu » selon les cinq éléments, il ne reste rien, ce qui revient à prouver que seuls ces composants existent et qu’il n’y a aucune « personne ». La pensée ne prouve donc pas davantage l’existence d’un soi, contrairement à ce que croient les gens, en général.
Quant au dernier groupe, la conscience sensorielle (viññāna), elle n’est qu’une fonction qui consiste à être pleinement conscient des objets perçus au travers des cinq sens. Ce n’est en aucun cas non plus un moi personnel. Les organes se contentent d’enregistrer la couleur, la forme, les sons, les odeurs, la saveur et les objets tactiles qui s’imposent à eux. Il en résulte une conscience de ces objets qui s’éveille en trois temps. Dans le cas de la vue, il y a une prise de conscience claire de la forme de l’objet observé : s’il s’agit d’un homme ou d’un animal, s’il est grand ou petit, blanc ou noir, etc. Une telle prise de conscience est un processus mécanique, qui se produit de lui-même, automatiquement. Certains prétendent qu’il s’agit d’une âme qui entre et sort de l’esprit, reçoit des stimuli au travers des organes des sens, et que là se situe le « moi ». Les bouddhistes n’y voient que l’œuvre de la nature : si un objet visuel entre en contact avec un œil et son nerf optique, la vision apparaît ainsi que la conscience de voir. Et ceci, une fois de plus, ne nécessite en aucune façon la présence d’un soi.
Après avoir analysé « l’être » et l’avoir ainsi décomposé en agrégats – c’est-à-dire le corps, la sensation, la perception, la pensée et la conscience sensorielle – nous n’en trouvons aucun qui puisse prétendre être un soi ou appartenir à un soi. Nous pouvons donc rejeter complètement cette fausse idée et conclure que nul n’est ou ne possède un soi. Celui qui cesse de se saisir des choses, de les aimer ou de les détester, montre qu’il a perçu le non-soi de toute chose. La pensée rationnelle doit suffire à prouver qu’il n’y a pas de soi ; cependant il n’en résulte généralement qu’une croyance, une opinion, et non la perception claire et entière qui permettrait de couper définitivement l’attachement à un « moi ». C’est la raison pour laquelle nous devons étudier attentivement les cinq agrégats sur la base du triple apprentissage et développer suffisamment de perception intérieure pour être en mesure d’abandonner notre attachement à l’idée d’un soi. Cette pratique vise à développer la sagesse et à éliminer l’ignorance. Alors seulement, nous pourrons voir par nous-mêmes qu’aucun des agrégats n’est un soi, et qu’aucun ne vaut la peine que l’on s’y attache. Toutes les formes d’attachement, même celles, instinctives, qui existent depuis la naissance, cesseront alors définitivement. C’est pourquoi il est essentiel que nous approfondissions notre connaissance des cinq agrégats qui sont à la base du mythe du « soi ». Le Bouddha a particulièrement insisté sur cet aspect de son enseignement. On peut le résumer ainsi : « Aucun des agrégats n’est un soi. » Il s’agit là d’un point clé du bouddhisme, que ce soit du point de vue de la philosophie, de la science ou de la religion. Lorsque nous prenons conscience de cette vérité, l’attachement et la peur – qui sont basés sur l’ignorance – disparaissent, le désir n’a plus aucun moyen de se manifester, et ainsi prend fin la souffrance.
Pourquoi donc ne percevons-nous pas les cinq agrégats tels qu’ils sont ? A la naissance, nous ne comprenions rien au monde qui nous entourait ; ensuite, les connaissances que nous avons acquises étaient basées sur ce que notre entourage nous disait, et la façon dont on nous les a communiquées nous a induits à croire qu’il y avait un moi personnel en toute chose. C’est ainsi que la force de cette croyance en un soi, instinctive, primaire, que nous acquérons dès la naissance, s’accroît sans cesse au fil du temps. Dans le langage, nous utilisons les mots « je », « tu », « il », « elle », qui ne font que renforcer l’idée du moi. Nous disons aussi : « Voici M. X et voilà Mme Y. Il est le fils de M. Z et le petit-fils de Mme W ». Cette manière de parler nous encourage à nous identifier à une « personne ». En conséquence, aucun de nous n’est conscient de la façon dont il s’attache, chaque jour davantage, à un « moi ». Or, quand on s’attache au moi, la conséquence inévitable est l’égoïsme, et nos actions quotidiennes s’en ressentent. Si nous pouvons développer suffisamment de clairvoyance pour découvrir qu’il s’agit là d’une erreur, nous cesserons de nous attacher à ces idées de M. X et Mme Y, de classe sociale plus ou moins élevée, d’être humain ou animal, etc. et nous verrons que ce ne sont que des termes que l’homme a inventés pour faciliter la communication. Une fois cela compris, nous pourrons dire que nous nous sommes affranchis d’une forme de « tricherie sociale ». Lorsque nous examinons l’ensemble de ce qui constitue M. X, nous constatons qu’il n’est que l’amalgame d’un corps, de sensations, de perceptions, de pensées et d’une conscience sensorielle. Voilà une manière plus intelligente de considérer les choses. Ce faisant, on évite d’être piégé par la vérité relative du monde.
Il est possible de pousser l’analyse encore plus loin. Le corps physique, par exemple, peut se diviser grossièrement en éléments (terre, eau, air et feu) ou être analysé scientifiquement (carbone, hydrogène, oxygène, etc.). Plus nous approfondirons notre investigation, moins nous nous laisserons duper par l’illusion d’être une « personne ». En pénétrant sous la surface, nous constatons qu’il n’existe que des agrégats physiques et mentaux. Considérée sous cet angle, la « personne » disparaît. L’idée de M. X et Mme Y ou d’une certaine classe sociale disparaît. L’idée de « mon fils, mon mari, ma femme » disparaît. Lorsque nous considérons les choses à la lumière de la vérité absolue, nous ne trouvons que des agrégats, et en étudiant ces agrégats de près, nous leur trouvons un dénominateur commun : le vide. Chacun de ces agrégats est vide de ce que l’on appelle un « soi ». Nous sommes tous capables de constater cette absence. Dès lors, l’attachement et la peur n’auront plus aucune raison d’être ou de perdurer. Ils disparaîtront d’eux-mêmes, dissous, envolés définitivement, sans laisser de trace.
Il n’y a donc pas d’animaux, pas de personnes, pas d’éléments, pas d’agrégats. Il n’y a rien d'autre que le vide, l’absence de soi. Si nous cessons de nous saisir des choses, il est impossible de souffrir. Celui qui perçoit le vide de toutes choses n’est aucunement perturbé si on le qualifie de bon ou de méchant, de joyeux, de triste ou de quoi que ce soit. Tel est le fruit de la connaissance, de la compréhension et de la claire perception intérieure de la vraie nature des cinq agrégats, qui permet d’abandonner complètement les quatre formes d’attachement.
En résumé, toute chose, en ce monde, se retrouve dans les cinq agrégats – c’est-à-dire la matière, la sensation, la perception, la pensée et la conscience sensorielle. Chacun de ces groupes nous induit en erreur car, bien que totalement dénué de soi, il a le pouvoir d’attirer l’attachement et la peur. En conséquence, le commun des mortels désire posséder, désire être ou encore ne pas posséder, ne pas être, ce qui, dans tous les cas, ne contribue qu’à engendrer la souffrance, une souffrance qui ne s’étale pas nécessairement au grand jour, une souffrance cachée. Il est dans l’intérêt de chacun de mettre à profit les enseignements relatifs à la vertu, la concentration et la sagesse, afin d’éliminer définitivement et radicalement l’illusion relative aux cinq agrégats. C’est la voie de la liberté, de la libération de la souffrance. La vie devient pur émerveillement, l’esprit s’élève au-dessus de toute chose pour le restant de ses jours. Tel est le fruit de la vision pénétrante claire et parfaite, appliquée aux cinq agrégats.
Chapitre VII
LA VISION PÉNÉTRANTE
PAR
LA MÉTHODE NATURELLE
Dans ce chapitre, nous allons voir comment la concentration peut venir de manière naturelle aussi bien que résulter d’une pratique organisée. L'aboutissement est identique dans les deux cas : l’esprit est concentré et en mesure d’entreprendre une introspection extrêmement fine. Il faut cependant souligner que la concentration spontanée est, en général, suffisamment intense pour permettre l’introspection et la vision pénétrante, tandis que la concentration qui résulte d’un entraînement spécifique est souvent excessive pour les besoins de la cause, sans compter qu’elle risque d’engendrer une autosatisfaction très préjudiciable. En effet, l’esprit profondément concentré peut ressentir un bien-être si parfait que le méditant s’y attache ou s’imagine qu’il a atteint là le fruit de la Voie. Au contraire, la concentration spontanée, suffisante et adaptée aux besoins de l’introspection, est inoffensive et ne souffre d’aucun de ces désavantages.
Il y a, dans le Tipitaka, de nombreux exemples de personnes ayant atteint spontanément toutes les étapes de la Voie et ses fruits, souvent en présence du Bouddha, mais également plus tard, avec d’autres maîtres. Or ces personnes ne partaient pas dans la forêt pratiquer assidûment la concentration sur des objets particuliers comme cela a été prescrit, beaucoup plus tard, dans certains manuels.
Il est bien évident qu’il n’a fallu aucun effort délibéré aux cinq premiers disciples du Bouddha pour atteindre l’état d’Arahant en entendant son discours sur le non-soi, ni au millier d’ermites qui ont entendu son « sermon du feu ». La sagesse, aiguë et profonde, surgit tout naturellement. Ces exemples montrent que la concentration naturelle peut se développer d’elle-même lorsqu’un individu essaie de comprendre le sens profond d’un problème. La sagesse qui en découle, dans la mesure où elle est fermement établie, est certainement intense et très stable. Elle apparaît naturellement, automatiquement, de la même manière que lorsque l’esprit se concentre pour faire de l’arithmétique ou pour viser avant de tirer à l’arc. En temps normal, nous ne tenons pas compte de ce type de concentration car il n’offre rien de magique, de miraculeux ou d’impressionnant. Pourtant, par la simple force de cette concentration naturelle, la plupart d’entre nous pourrait atteindre la libération, le fruit de la Voie, le Nirvana, l’état d’Arahant.
Alors ne négligeons pas ce type de concentration que nous possédons tous, à un degré ou à un autre, et que nous pouvons toujours développer. Nous devons faire notre possible pour le cultiver, le faire fonctionner parfaitement, et en retirer les résultats appropriés, tout comme l’ont fait ceux qui sont devenus des Arahants sans avoir jamais entendu parler des techniques modernes de concentration.
Etudions, à présent, la nature des états de conscience qui permettent la vision pénétrante du « monde », c’est-à-dire des cinq agrégats. La première étape est la joie (piti), bonheur de l’esprit ou bien-être spirituel. Faire le bien, d’une manière ou d’une autre, même faire une offrande de nourriture aux moines – ce qui est considéré comme la forme la plus simple d’obtention de mérites – peut être source de joie. Plus haut sur l’échelle de la vertu, un comportement irréprochable en paroles et en actions peut apporter une joie plus grande encore. Puis vient la concentration, où nous découvrons un plaisir certain dès les tout premiers niveaux de la pratique.
Cette joie possède, en elle-même, la capacité de faire apparaître un état de tranquillité. D’ordinaire l'esprit part dans tous les sens, esclave des pensées et des sentiments associés aux attraits du monde – il est agité. Mais lorsque la joie spirituelle s’installe, inévitablement le calme et la stabilité de l’esprit augmentent en proportion ; et, quand la stabilité se perfectionne, il en résulte une concentration totale. L’esprit s’apaise, il devient souple et flexible, léger, détendu, prêt à servir n’importe quelle cause et, en particulier, la suppression des pollutions qui l’obscurcissent.
Ce n’est pas que l’esprit devienne silencieux et le corps rigide comme un roc – absolument pas. Le corps est ressenti comme étant dans son état normal mais l’esprit est particulièrement calme, parfaitement clair, frais et alerte, autrement dit « apte au travail », prêt à apprendre. Tel est le degré de concentration qu’il faut rechercher plutôt qu’une concentration trop profonde, où le méditant se retrouve comme une statue de pierre, dénuée de toute présence consciente. Ce type de concentration ne permet pas d’approfondir quoi que ce soit, ne se prête à aucune espèce d’investigation. L’esprit n’étant pas présent, il n’a aucun moyen d’atteindre la vision pénétrante. La concentration profonde est un obstacle majeur à la pratique de la vision pénétrante. Pour pratiquer l’introspection, il faut d’abord retourner à un niveau de concentration moins profond ; on peut alors utiliser la force acquise par l’esprit lors de sa plongée. Ainsi la concentration profonde peut être un outil, mais seulement un outil. Ce que nous devons rechercher plutôt, c’est un esprit calme et stable, et tellement apte au travail que, lorsqu’on l’applique à la pratique de la vision pénétrante, il obtienne une compréhension juste de tous les phénomènes du monde. Une telle vision est tout à fait naturelle, elle est semblable à celle obtenue par les disciples du Bouddha lorsqu’ils l’écoutaient enseigner le Dhamma. Elle n’inclut ni rituels ni miracles mais engendre introspection et pensées justes – de celles qui mènent à la compréhension.
Cela ne veut pas dire pour autant que la sagesse naîtra spontanément. On ne devient pas Arahant instantanément. Le premier pas sur le chemin de la connaissance peut survenir n’importe quand, selon l’intensité de la concentration. Il se peut aussi que ce qui apparaît ne soit pas la véritable sagesse, du fait d’une pratique erronée ou parce que les bases de la connaissance sont fausses. Cependant, quoi qu’il en soit, la vision qui apparaît ne peut être que très spéciale, particulièrement claire et profonde. Si la connaissance qu'elle révèle correspond à la réalité, au Dhamma, elle continuera à progresser jusqu’à devenir une connaissance juste et vraie de tous les phénomènes. Si la sagesse ne se développe que dans une certaine mesure, elle transformera quelqu’un en ariyan du premier niveau ou au moins en un individu de valeur. Si l’environnement s’y prête et que de bonnes qualités ont été correctement développées et renforcées, il est possible d'avancer ainsi jusqu'au niveau de l'Arahant. Tout dépend des circonstances. Mais quelle que soit la distance parcourue, tant que l’esprit possède la capacité de concentration naturelle, cet élément que nous appelons « vision pénétrante » ne peut manquer de s’éveiller et de correspondre plus ou moins à la réalité. En ce qui concerne les bouddhistes qui ont entendu parler du « monde « (les cinq agrégats et les phénomènes), qui y ont réfléchi et qui l’ont étudié pour en comprendre la véritable nature, la connaissance qui découlera de leur état de concentration paisible ne sera en aucun cas trompeuse. Elle ne peut qu’être toujours bénéfique.
L’expression « vision pénétrante de la véritable nature des choses » signifie voir l’impermanence, l’insatisfaction et le non-soi de toute chose, voir que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou d’être, voir que nous ne devrions nous attacher à absolument rien en ce monde, car rien n'est ou ne possède un soi propre, rien n'est bon ou mauvais, attirant ou repoussant. Le simple fait d’aimer ou de ne pas aimer quelque chose, ne serait-ce qu’une idée ou un souvenir, est une forme d’attachement. Dire que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou d’être signifie la même chose que « rien ne vaut la peine que l’on s’y attache ». « Obtenir » c’est, par exemple, souhaiter ardemment des biens ou une position, de l’argent ou un quelconque objet de plaisir. « Etre » signifie ici avoir conscience de son statut : être marié, pas marié, riche, pauvre, gagnant ou perdant, et même la conscience d’être quelqu’un, d’être une personne. Si nous y regardons de très près, même être quelqu’un n’est pas drôle, c’est lassant car source de souffrance. Si nous pouvons abandonner complètement notre attachement à l’idée que nous sommes « quelqu’un », alors être ne sera plus une souffrance. Voilà ce que nous gagnons à voir l’inanité de l’être. C’est le sens profond de cette affirmation selon laquelle tout entraîne inévitablement une souffrance en rapport avec son état particulier. Pour se perpétuer, tout état doit perdurer, au moins en esprit, sous forme d’une croyance en sa propre existence. Ensuite, lorsqu’il y a « une personne », inévitablement il y a des objets autres qu’elle, qui lui appartiennent : des enfants, un conjoint, telle ou telle possession, etc. Puis viennent les devoirs qui s’imposent au mari, à la femme, au travailleur, etc. Tout ceci tend à démontrer la justesse du fait que tout état, pour se maintenir, nécessite un effort. Les problèmes et la souffrance engendrés pour maintenir notre position ne sont que le résultat d’un amour aveugle pour les choses, d’un attachement aux objets.
Et maintenant, si nous abandonnions l’envie de posséder ou d’être quelque chose, comment pourrions-nous continuer à exister ? Voilà certainement une question qui fait sourire les sceptiques et ceux qui n’auraient pas sérieusement réfléchi à la question. Le sens des mots « posséder » et « être » tels qu’ils sont utilisés ici se réfèrent à ce qui est obtenu et vécu au travers des pollutions de l’esprit, de la convoitise, à l’idée que « cela vaut la peine d’être obtenu ou vécu », de sorte que l’esprit s’y applique très sérieusement. Une telle attitude ne peut que mener à la dépression, l’angoisse, la détresse, le bouleversement ou, au minimum, à une anxiété permanente. Sachant cela, nous allons pouvoir être très attentifs et veiller à ce que notre esprit ne soit jamais la proie du désir de posséder ou d’être. Conscients qu’en réalité rien ne vaut la peine d’être obtenu ou d’être, nous aurons l’intelligence d’en rester éloignés.
Cependant, s’il ne nous est pas possible de nous éloigner complètement des choses de ce monde, nous devons être extrêmement vigilants, de sorte que, si nous possédons effectivement quelque chose, ce soit avec un détachement total. Nous ne ferons pas comme ces personnes qui se bouchent les yeux et les oreilles et, sans réfléchir, s’enfoncent toujours davantage dans le désir d’obtenir et d’être jusqu’à sombrer dans le puits de leur propre ignorance et de leur attachement, et finir par se suicider.
Le monde – et tout ce qu’il comporte – a la particularité d’être impermanent, sans valeur intrinsèque et de n’appartenir à personne. Quiconque essaie de posséder quelque chose ou de s’y attacher en souffrira tout au long : dès le début, lorsque le désir d’être ou d’obtenir le brûle ; ensuite, tandis qu’il poursuit son but ; et plus tard encore, quand il obtient ce qu’il désire. A chaque étape, avant, pendant et après, quand on cherche aveuglément à obtenir ou à s’approprier quelque chose, la coupe est pleine de souffrance. Nous pouvons le constater en regardant souffrir autour de nous tous les êtres qui vivent dans l’ignorance. Il en va de même pour la bonté, bien qu’elle soit généralement très prisée. Si l’on s’engage dans les bonnes actions de manière erronée et que l’on s’y attache trop, on en retirera autant de souffrance que ceux qui font le mal. Lorsque l’on s’engage sur la voie de la bonté, on ne doit pas oublier qu’elle possède les mêmes caractéristiques.
Un sceptique dira : « Si absolument rien sur cette terre ne vaut la peine d’être vécu ou obtenu, doit-on en conclure que nous ne devrions pas travailler, gagner de l’argent, acquérir une position sociale ou des biens ? » Il est pourtant simple de comprendre que celui qui avance dans la vie avec la connaissance et la compréhension justes est bien plus avantagé pour entreprendre une tâche que celui qui est esclave de ses désirs et ignorant de ces choses. En bref, en nous engageant dans le monde, nous devons rester attentifs et veiller à ce que nos actions ne soient pas motivées par le désir. Le résultat s’ensuivra en conséquence.
Le Bouddha et tous les autres Arahants étaient totalement libérés du désir et ils réussirent pourtant à accomplir des choses beaucoup plus utiles que ce qu’aucun d’entre nous pourrait faire. Dans les récits sur la vie du Bouddha, il est dit qu’il ne dormait que quatre heures et passait le reste du temps à travailler. Nous passons plus de quatre heures par jour simplement à nous divertir ! Si le Bouddha et tous les Arahants avaient éliminé ces pollutions qui engendrent le désir d’obtenir et d’être, alors quelle était leur motivation au travail ? Eh bien, ils étaient motivés par le discernement doublé de compassion. Même les actions basées sur les besoins naturels du corps, telles que recevoir et manger la nourriture, étaient guidées par le discernement. Ils étaient libres de toute impureté, libres de tout désir de continuer à vivre pour être ceci ou obtenir cela, mais ils avaient assurément la capacité de discerner ce qui valait la peine d’être fait et ce qui n’en valait pas la peine ; telle était la force de motivation qui poussait leur corps à aller chercher de la nourriture. S’ils en trouvaient, très bien ; sinon, tant pis. Quand ils avaient la fièvre, ils savaient comment la soigner et le faisaient aussi bien que possible. Mais si la fièvre était très forte et qu’ils étaient de constitution fragile, ils se souvenaient que la mort est un phénomène naturel. Qu’ils vivent ou meurent, cela n’avait aucune signification, cela avait la même valeur à leurs yeux.
Telle est la meilleure attitude à avoir pour être entièrement libéré de la souffrance. Il est inutile qu’il y ait un « moi » qui soit maître du corps. Le simple discernement permet au corps de se maintenir selon une force naturelle. L’exemple du Bouddha montre que le pouvoir du pur discernement et de la pure bonté suffit à maintenir un Arahant en vie dans le monde et, qui plus est, à lui permettre d’accomplir beaucoup plus de bienfaits pour autrui que ne pourraient le faire ceux qui sont sujets à l’attachement. L’ignorant agira inévitablement pour son seul profit, puisqu’il est motivé par l’égoïsme, tandis que les actions de l’Arahant en sont totalement dépourvues et donc parfaitement pures. Mue par le désir d’être et d’obtenir, notre action est erronée, nous prenons le mal pour le bien ne sachant pas « ce qui est ». Alors, abordons les choses intelligemment ! N’oublions jamais qu’en réalité rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu, rien ne vaut la peine que l’on s’y attache. Agissons plutôt de manière cohérente : sachant que, de par leur nature même, les choses n'ont aucune valeur, s’il nous faut vraiment participer à ce monde, faisons-le de manière juste et appropriée. Ainsi notre esprit restera pur, clair, paisible et léger. Nous pourrons participer aux affaires du monde sans en souffrir.
Quand un homme ordinaire entend dire que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu, il n’est pas convaincu et refuse de le croire. Mais quiconque en comprend le sens réel se sent affermi et joyeux. Son esprit maîtrise les choses et en est indépendant. Il devient capable de poursuivre des objectifs sans craindre d’en devenir l’esclave. Ses actions ne sont pas motivées par le désir et il n’est aveuglé par aucune passion qui l’enchaînerait aux choses. Dans le fait d’obtenir ou d’être quelque chose, soyons toujours conscients qu’en réalité, en termes de vérité absolue, nous ne pouvons rien obtenir ou être car il n’existe rien que nous puissions obtenir ou être selon nos souhaits. Tout est impermanent et insatisfaisant, et rien ne peut jamais nous appartenir. Et pourtant nous avançons dans la vie comme des ignorants, pleins de désirs et d’attachements. Autrement dit, nous agissons de manière inadéquate, en désaccord avec la nature véritable des choses, tout simplement parce que nous l'ignorons. Inévitablement cela entraîne toutes sortes de problèmes et de souffrances. Nous sommes incapables de faire notre travail à la perfection parce que nous sommes beaucoup trop préoccupés par nos propres désirs de constamment être ou obtenir quelque chose. En conséquence, nous ne maîtrisons rien et ne pouvons être bons, honnêtes et justes en toutes circonstances. La cause première de toutes les situations d’échec et de désastre est l’asservissement au désir.
Apprendre à connaître la véritable nature des choses est l’objectif réel de tout bouddhiste. C’est le moyen de nous libérer. Indépendamment du fait que nous espérions, ou pas, en retirer des bénéfices dans ce monde (richesse, position sociale et célébrité) ou dans l’au-delà (sphère céleste), ou encore des bénéfices supra-mondains (le fruit de la Voie ou Nirvana), quoi que nous en espérions, le seul moyen de l’atteindre est la connaissance juste et la vision pénétrante. Nous nous enrichissons par la vision pénétrante. Il est dit, dans les Ecritures, que nous serons purifiés par la vision pénétrante et par rien d’autre. Notre chemin vers la libération passe par la vision pénétrante, la perception claire qu’en toute chose il n’y a et il n’y aura jamais quoi que ce soit qui vaille la peine de s’y attacher, d’être obtenu ou vécu, de risquer sa vie. Nous possédons des choses et sommes quelque chose, seulement en termes de vérité relative. Dans le langage du monde, nous disons que nous sommes ceci ou cela, simplement parce qu’en société il est pratique de donner aux choses des noms et des titres. Mais nous ne devons pas croire que nous sommes réellement ceci ou cela, comme on le prétend au niveau de la vérité relative. Agir ainsi serait agir comme les criquets qui perdent tout sens de l’orientation quand leur tête est recouverte de poussière, au point de se battre et de s’entre-tuer. Nous, les humains, lorsque notre tête est recouverte de poussière, c’est-à-dire quand nous sommes la proie de toutes sortes de concepts erronés, nous sommes tellement désorientés que nous faisons des choses qu’aucun être humain ne ferait dans des circonstances normales – comme tuer, par exemple. Alors, ne nous laissons pas asservir aveuglément par des vérités relatives ; soyons plutôt conscients du fait qu’elles ne sont que relatives, nécessaires pour la vie en société mais sans plus. Nous devons prendre conscience de ce que sont réellement ce corps et cet esprit, quelle est leur véritable nature. Prendre conscience, en particulier, de leur impermanence, de l’état d’insatisfaction qui leur est inhérent, et de l’absence de soi personnel, et faire en sorte de ne jamais nous identifier à eux.
En ce qui concerne la richesse, le statut social, et toutes ces choses dont nous ne pouvons nous passer, considérons-les également comme des vérités relatives, de façon à nous libérer de la façon habituelle de s’exprimer : « Ceci appartient à X et cela à Y ». La législation du pays veille au respect de la propriété, inutile que nous nous cramponnions en plus à l’idée que « c’est à moi ». Nous ne devrions posséder des choses que pour des raisons pratiques, purement et simplement, et non pour que ces possessions dominent notre esprit. Lorsque l’on sait cela, les objets deviennent nos serviteurs et nous les dominons en toute occasion. Par contre, si nos pensées dérivent vers le désir et l’attachement, si nous sommes persuadés de posséder ceci et cela, d’être ceci et cela, et que nous nous cramponnons à ces idées, les choses matérielles nous dominerons et c’est nous qui en serons les esclaves. Les situations peuvent facilement se retourner ainsi ; il nous faut donc être très vigilants. Nous devons organiser notre vie de telle sorte que nous soyons toujours sûrs d’être indépendants des choses et de les dominer. Sinon nous risquons fort de nous retrouver dans des situations peu enviables et de nous apitoyer sur notre sort.
Lorsque nous avons enfin perçu clairement que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu, apparaît le désenchantement (nibbidā) qui se développe proportionnellement à l’intensité de la vision pénétrante. C’est signe que l’attachement commence à se relâcher, signe que nous avons été esclaves pendant si longtemps que l’idée d’essayer de nous échapper nous est enfin venue. C’est le début du désenchantement et de la désillusion : nous en avons assez de notre propre aveuglement à désirer des choses et à nous y cramponner comme si elles en valaient la peine. Dès que le désenchantement s’installe, inévitablement commence un processus naturel et automatique de détachement (virāga) – comme si une corde avec laquelle nous étions fortement attachés se dénouait, ou comme la teinture d’un tissu disparaît au rinçage. Le Bouddha a appelé ce processus – selon lequel l’attachement fait place à une dissolution ou à une libération du monde ou des objets de cet attachement – « émancipation » (vimutti). Cet état est extrêmement important ; bien qu’il ne soit pas l’étape finale, c’est un pas très net vers la libération totale. Arrivés à ce stade d’émancipation, la libération complète de la souffrance nous est assurée.
Une fois libres, nous ne serons plus jamais esclaves du monde. Etre esclave des choses c’est être pollué dans son corps, ses paroles et ses pensées. Se libérer de l’esclavage des parfums délicieux du monde, c’est atteindre l’état de pureté et ne jamais plus risquer d’être souillé. Cette pureté absolue (visuddhi) une fois atteinte donnera naissance à un calme, à une authentique sérénité, libre de toute agitation, lutte ou tourment. Le Bouddha a appelé cette cessation de l’oppression et de l’agitation « paix » (santi), tout simplement, c’est-à-dire calme, sérénité en toute situation, ce qui est virtuellement la même chose que le Nirvana.
Le mot « nirvana » a parfois été traduit comme « absence de tout instrument de torture » mais aussi comme « extinction sans laisser de traces ». Il a donc deux significations importantes : premièrement, libération de toute source de tourment et de brûlure, de toutes les formes d’attachement et de contrainte ; deuxièmement, extinction de toute souffrance, sans aucun combustible restant pour la perpétuer. La combinaison de ces deux significations indique qu’il s’agit d’un état de totale liberté par rapport à la souffrance. Il existe plusieurs autres sens intéressants du mot « Nirvana ». Il peut signifier l’extinction de la souffrance ou l’élimination complète des poisons du mental ou encore l’état, la sphère ou la condition qui est la cessation de toute souffrance, de toute pollution et de toute activité karmique. Bien que le mot Nirvana soit souvent utilisé, le sens qu’on lui donne peut beaucoup varier. Pour certains, il signifiera, par exemple, « calme et sérénité » parce qu’on l’identifie à la concentration profonde ; tandis que d’autres vont jusqu’à appeler « nirvana » l’absorption totale dans la sensualité !
Le Bouddha a défini le Nirvana simplement comme l’état de liberté par rapport à l’attachement, le tourment et la souffrance ; état qui résulte de l’observation de la véritable nature des choses de ce monde et de la capacité qui s’ensuit d’abandonner tout attachement envers elles. Il est donc essentiel que nous réalisions l’immense valeur de la vision pénétrante de la véritable nature des choses et que nous nous appliquions à développer cette vision d’une manière ou d’une autre. Avec la méthode naturelle, nous l’encourageons à apparaître d’elle-même, simplement, en développant nuit et jour la joie qui résulte de la pureté de l’esprit, jusqu’à ce que les qualités que nous avons décrites fassent surface. L’autre méthode consiste à développer la force de l’esprit en suivant une technique de concentration précise et en pratiquant la vision pénétrante. Cette méthode-là s’adresse aux personnes ayant certaines dispositions préalables et capables de faire de rapides progrès dans des circonstances appropriées. Mais nous pouvons également pratiquer le développement de la vision pénétrante par la méthode naturelle, en tout temps et en tout lieu, simplement en vivant notre quotidien de manière si pure et honnête que progressivement vont apparaître la joie spirituelle (pīti et pamoda), le calme (passaddhi), la vision pénétrante de la véritable nature des choses (yathābhūtañāna-dassana), le désenchantement (nibbidā), le détachement (virāga), la libération (vimutti), la purification des pollutions mentales (visuddhi) et la sérénité (santi). Nous avons ainsi un avant-goût du Nirvana (nibbāna), la libération de toute souffrance, régulièrement, naturellement, au jour le jour, mois après mois, année après année, nous rapprochant peu à peu du Nirvana final.
En résumé, la concentration et la vision pénétrante naturelle, qui permettent d’atteindre « la Voie et le fruit », consistent à vérifier, chaque jour et à longueur de journée, la vérité de l’affirmation selon laquelle rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Quiconque souhaite atteindre ce résultat doit s’efforcer de se purifier et de développer des qualités personnelles exemplaires, de façon à trouver une constante joie spirituelle, dans le travail comme dans les loisirs. Cette joie entraînera la clarté et la fraîcheur, le calme de l’esprit et la tranquillité ; elle donnera à l’esprit, de manière naturelle et automatique, une certaine capacité de réflexion et d’introspection. Avec la vision claire et constante que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu, l’esprit perd tout désir des objets qui lui paraissaient autrefois si attirants et attachants, et il peut enfin se libérer de ce qu’il appelait « moi » et « mien ». Toute convoitise aveugle pour les choses prend fin. La souffrance, qui ne trouve plus où se loger, s’efface aussitôt, et ainsi s’achève la tâche qui consistait à l’éliminer. C’est la récompense – et chacun d’entre nous peut y prétendre.
Chapitre VIII
LA VISION PÉNÉTRANTE PAR LA PRATIQUE
Nous allons maintenant étudier les techniques de pratique de la vision pénétrante qui n’ont pas été enseignées par le Bouddha mais ont été développées plus tard par des maîtres de méditation. Ce type de pratique convient aux personnes qui en sont à un stade assez peu développé et ne peuvent pas encore percevoir spontanément, par elles-mêmes, l’insatisfaction de l’existence de ce monde. Cela ne signifie pas pour autant que les résultats obtenus par ces techniques aient des vertus supérieures à ceux obtenus par la méthode naturelle car, lorsque nous lisons le Tipitaka, nous constatons que seule la méthode naturelle y est mentionnée. Certains considèrent cependant que la vision pénétrante naturelle ne peut être développée que par ceux qui ont déjà atteint un tel degré de vertu et une telle prédisposition, qu’atteindre une pleine compréhension des choses leur est un jeu d’enfant. Que doivent donc faire ceux qui n’ont pas ces vertus transcendantes et la prédisposition appropriée ? C’est à leur intention que des maîtres ont mis au point des techniques progressives de pratique, des leçons claires et précises qui vont de A jusqu’à Z, et doivent être suivies pas à pas, sérieusement et systématiquement.
Ces formes de pratique de développement de la vision pénétrante sont, à présent, connues sous le terme technique de vipassanā-dhura. On oppose vipassanā-dhura à l’étude (gantha-dhura), les deux étant considérés aujourd’hui comme des aspects complémentaires de l’enseignement. Vipassanā-dhura est l’étude vécue à l’intérieur ; c’est une formation de l’esprit qui n’a rien à faire avec les livres. Aucun de ces deux termes n’est mentionné dans le Tipitaka ; ils n’apparaissent que beaucoup plus tard, dans d’autres écrits. Vipassanā-dhura n’en est pas moins une authentique pratique bouddhiste à l’intention de ceux qui souhaitent se libérer de la souffrance. Elle est directement fondée sur une introspection soutenue et concentrée. Pour aborder vipassanā, les anciens maîtres s’exprimaient ainsi :
- Quelle est la base, le fondement de vipassanā ?
- Quelles sont les caractéristiques qui permettent de reconnaître vipassanā ?
- Quelle est au juste cette activité que nous appelons vipassanā ?
- Quel devrait être l’aboutissement ultime de vipassanā ?
En réponse à la première question, relative aux fondements de vipassanā, nous répondons : vertu et concentration. « Vipassanā » signifie « vision pénétrante » et se réfère à cette vision claire qui apparaît lorsque l’esprit est joyeux et libre de toute pollution. Comme la joie se développe en présence de la pureté morale (sīla-visuddhi), un comportement sain et honnête est une base morale indispensable. Ceci est exprimé dans les textes (Rathavinīta Sutta, Majjhima Nikāya, 24) où la pratique est décrite comme découlant d’une série d’étapes appelées « les sept purifications » qui culminent sur la Voie et ses fruits. Les maîtres considèrent l’étape de la pureté morale comme la première des sept purifications. Elle nécessite une attitude irréprochable et sert de base à la purification de l’esprit (citta-visuddhi). Celle-ci est atteinte quand on parvient à libérer l’esprit de toute contamination, accédant ainsi à la purification des idées (ditthi-visuddhi) qui met fin à toute possibilité de mauvaise compréhension. Cette nouvelle liberté mène à la pureté générée par la fin du doute (kankhā-vitarana-visuddhi), laquelle conduit, à son tour, à l’apparition de la pureté par la connaissance et la vision de ce qu'est la véritable voie à suivre et ce qui ne l’est pas (maggā-magga-ñānadassana-visuddhi). Cette connaissance de la Voie mène à la pureté par la connaissance et la vision du progrès le long de la Voie (patipadā-ñānadassana-visuddhi). On est ainsi conduit à l’étape où la vision pénétrante est totale et intuitive : c’est la pureté de la connaissance et de la vision (ñānadassana-visuddhi) qui est la perfection du Noble Sentier. Du fait que le fruit de la Voie est automatiquement obtenu une fois que l’on est engagé sur la Voie, atteindre la Voie est considéré comme le summum de la pratique.
Pureté morale signifie avoir une attitude irréprochable vis-à-vis de tout ce qui concerne le corps et la parole. Tant qu’il reste la moindre imperfection dans le comportement du corps ou de la parole, on peut dire qu’il n’y a pas de vertu ou « moralité » au vrai sens du terme. Par contre, quand la vertu a été perfectionnée, c’est-à-dire que l’on a atteint la sérénité dans les activités du corps et de la parole, le résultat ne peut manquer d’apparaître sous l’aspect de la tranquillité, laquelle à son tour mène aux étapes suivantes de purification. C’est la fin de l’incompréhension, la fin du doute, de la discrimination entre ce qu’est la Voie à suivre et ce qui ne l’est pas. C’est la connaissance et la vision du progrès le long de la Voie, et finalement, c’est la vision pénétrante complète et intuitive. Ces cinq dernières étapes constituent vipassanā à proprement parler. La purification de la conduite et de l’esprit ne sont que la porte qui ouvre sur la voie de vipassanā.
Les sept purifications
Les cinq étapes de Vipassana
Les neuf étapes de la perfection de la connaissance
I. Pureté morale
II. Pureté de l’esprit
III. 1/ Fin des idées fausses
IV. 2/ Fin du doute
V. 3/ Connaissance et vision de ce qu’est la vraie Voie.
VI. 4/ Connaissance et vision du progrès le long de la Voie :
(a) Prise de conscience du début et de la fin des phénomènes
(b) Prise de conscience de la fin des phénomènes
(c) Conscience de la peur
(d) Conscience du danger
(e) Désenchantement
(f) Désir de liberté
(g) Lutte pour s’échapper
(h) Imperturbabilité
(i) Capacité de comprendre les Quatre Nobles Vérités
VII. 5/ Vision pénétrante complète et intuitive
(III. 1)
La purification qui libère d’une mauvaise compréhension des choses implique l’élimination des toutes les idées fausses, innées et acquises, depuis les croyances irrationnelles dans la magie jusqu’aux idées fausses sur la véritable nature des choses. Par exemple, considérer le corps et l’esprit comme quelque chose de constant, d’important, un « soi » ; le considérer comme un être animal, humain, céleste ou divin, ou encore comme quelque chose de magique ou de sacré. Ne pas voir qu’il consiste simplement en quatre éléments, ou juste en un corps et un esprit, et le considérer au contraire comme un soi, possédant une âme qui y entre et en ressort. Ne pas voir qu’il ne se compose que de cinq agrégats : le corps, les sensations et sentiments, les perceptions, la pensée active et la conscience sensorielle. Ne pas le voir comme une simple masse de perceptions reçues au moyen de l’œil, de l’oreille, du nez, du palais, du corps et de l’esprit.
Les concepts erronés conduisent à la croyance en la magie et les objets sacrés, et engendrent ainsi la peur. Des rites et rituels sont alors célébrés pour neutraliser la peur avec, pour résultat final, un attachement aux rites et rituels – tout cela à cause de concepts erronés. Une telle situation indique que les pensées ne sont pas encore irréprochables. Avoir abandonné les idées fausses, c’est avoir atteint ce que l’on appelait autrefois « la troisième purification » et que les maîtres ont ensuite appelé « la première étape de vipassanā ».
(IV. 2)
La purification qui libère du doute provient de l’introspection dans les causes. Une fois libéré des idées fausses, on se perçoit comme n’étant que l’amalgame d’un corps et d’un esprit. Etre libre du doute signifie percevoir la nature des causes qui sont à l’origine de l’existence de l’ensemble corps-esprit. On voit, de manière pénétrante et dans tous leurs détails, l’apparition et l’interaction de l’ignorance, du désir, de l’attachement, du karma, de la « nourriture » , etc. qui constituent le corps et l’esprit. La libération du doute résulte simplement de la connaissance claire des causes et des effets de toute chose. Dans la technique de vipassanā, les maîtres ont distingué vingt-neuf ou trente types de doute mais, tout compte fait, ils se résument tous à une seule question : notre « soi » existe-t-il, a-t-il déjà existé, et continuera-t-il à exister dans le futur et, dans ce cas, sous quelle forme ? Le seul moyen de faire disparaître définitivement ce doute est de réaliser qu’il n’y a pas de « soi » mais seulement des éléments, des agrégats et un système nerveux qui se mêlent à l’ignorance, la convoitise, et l’attachement, au karma et à la « nourriture », etc. C’est parce qu’il n’y a pas de « je » du tout que l’on peut commencer à abandonner l’idée floue de « je suis, j’ai été, je serai ». Avec l’éradication totale du doute, on atteint la seconde étape de vipassanā. Cela ne signifie pas que l’illusion du « je » a été abandonnée définitivement ; il en reste quelques vestiges. Mais une bonne compréhension du mode d’interaction des causes a permis de faire s’évanouir le doute et d’abandonner l’idée du « je » dans ses formes les plus grossières.
(V. 3)
Une fois le doute transcendé, il est possible d’aborder la purification qui consiste à distinguer le juste sentier à suivre de ce qui ne l’est pas. Il y a plusieurs obstacles à ce nouveau progrès, obstacles qui apparaissent généralement pendant la pratique de vipassanā. Tandis que l’esprit est dans un état de concentration, il peut se produire des phénomènes étranges qui risquent d’impressionner fortement le méditant, telles des lumières merveilleuses apparaissant à l’œil intérieur (les yeux physiques étant fermés). Si ces manifestations sont encouragées, elles peuvent se développer énormément. Pour le méditant qui saute à la conclusion que « ce sont les fruits de la pratique de vipassanā » ou qui se félicite en pensant : « Voilà quelque chose de miraculeux qui me convient parfaitement », de tels phénomènes risquent fort d’obstruer le reste de la Voie et de ses fruits. C’est pourquoi les maîtres considèrent qu’il s’agit là d’une déviation, d’une impasse. Il existe d’autres types de déviation, comme quand des sentiments de joie débordante et de satisfaction envahissent si fort l’esprit qu’il n’est plus capable d’introspection et saute à la conclusion que « c’est le Nirvana, ici et maintenant ». En fait, la route se bloque, et tout progrès devient impossible. Les maîtres disent que même la vision claire de la nature du corps et de l’esprit peut conduire le méditant à l’autosatisfaction et à l’illusion qu’il a atteint un degré remarquable de compréhension spirituelle, ce qui le rend trop confiant. C’est un autre des obstacles au progrès de vipassanā. Il arrive aussi que le méditant utilise les pouvoirs qu’il a ainsi développés pour rendre son corps rigide au point de perdre toute la conscience nécessaire au progrès de l’introspection. C’est un obstacle difficile à surmonter car les méditants en sont généralement très satisfaits, considérant cela comme un pouvoir surnaturel ou même comme le fruit de la Voie. Ils sont, en fait, très à plaindre.
Une autre situation, que l'on rencontre aussi fréquemment, est l’apparition d’un état de béatitude tel que le méditant n’en a jamais connu. Emerveillement et étonnement précèdent une autosatisfaction absolument injustifiée. Tant que dure cette béatitude, le corps et l’esprit sont dans un état de bien-être profond et tous les problèmes disparaissent. Ce que l’on aimait ou que l’on n’aimait pas, nous est tout à coup indifférent quand on y pense. Ce que le méditant avait craint, ce qui l’inquiétait, l’angoissait, le bouleversait ne provoque plus aucune de ces réactions, de sorte qu’il croit à tort avoir déjà atteint la libération de tous les poisons mentaux ; car il est vrai que, tant qu’il est dans cet état, il a toutes les caractéristiques d’un individu ayant réellement atteint la perfection. Mais si la satisfaction apparaît en réponse à cet état, elle sera un obstacle à la suite du progrès dans vipassanā ; puis, avec le temps, cet état s’affaiblira de sorte que l’on recommencera à aimer ou à ne pas aimer les choses, comme avant, et peut-être même plus fort qu’avant.
Un autre obstacle peut provenir de la foi, d’une confiance plus grande que jamais : confiance dans le Triple Joyau – le Bouddha, le Dhamma et le Sangha – ou dans des théories que le méditant se crée lui-même. Il peut aussi ressentir une intense satisfaction dans le Dhamma. La capacité à rester détaché de tout se développe tant et si bien qu’elle peut faire croire au méditant qu’il a déjà atteint le fruit de la Voie et même le Nirvana. Ces phénomènes représentent de grosses difficultés pour ceux qui les rencontrent pour la première fois – même si les méditants les trouvent souvent très à leur goût – jusqu’à ce qu’ils atteignent enfin la connaissance permettant de voir clairement ces expériences comme des obstacles et qu’ils réussissent à se défaire totalement de ces pollutions subtiles. Ils découvrent alors ce qu’est réellement la Voie et ce qui ne l’est pas. Cette connaissance est la troisième étape de vipassanā et la cinquième purification.
(VI. 4)
Jusque-là, l’aspirant doit veiller à se tenir à l’écart de toutes les voies adjacentes. Par contre, dès qu’il saura précisément distinguer la Voie juste, tout ce qu’il découvrira par la suite découlera automatiquement de cette Voie. Cette connaissance se développera progressivement ; elle apportera une compréhension parfaitement claire de la véritable nature des choses et, finalement, une parfaite liberté et un détachement total vis-à-vis de ces choses. Quant à l’esprit, enrichi de cette compréhension, il est prêt à atteindre la vision pénétrante des Quatre Nobles Vérités. On dit qu’il a atteint l’état de pureté qui découle de la connaissance et de la vision du progrès sur la Voie. C’est la quatrième étape de vipassanā et la sixième purification. Le Tipitaka ne donne aucun détail sur cette étape mais, plus tard, certains maîtres l’ont subdivisée ainsi :
a) L’aspirant a progressé correctement en vipassanā et a pu approfondir en détail les phénomènes de la naissance, du vieillissement, de la douleur et de la mort de toute chose. Le début et la fin de tout phénomène ont été parfaitement observés. Toute existence phénoménale est clairement perçue comme n’étant qu’un processus infini de naissance et de mort, de début et de fin, comme les lueurs du soleil à la surface de la mer ou comme la formation de la crête moutonneuse des vagues et leur dispersion. C’est ce que l’on appelle « la connaissance du début et de la fin » (udayabbayā-nupassanā-ñāna). Elle naît d’une introspection concentrée, si claire et maintenue si longtemps, que la connaissance est fermement établie, comme une teinture absorbée par l’esprit, assez puissante pour provoquer chez le méditant un désenchantement par rapport aux choses et la fin de l’attachement. Telle est la première étape de la connaissance et de la vision du progrès sur la Voie.
b) Si le début et la fin des phénomènes sont observés simultanément, il est impossible de les percevoir aussi clairement que lorsque l'on se concentre sur eux séparément. A ce stade, le méditant abandonne l’observation du début, et se concentre exclusivement sur la fin. Ceci lui permet de voir le processus de désintégration et de disparition avec une telle profondeur et une telle intensité qu’il en vient à réaliser que la décrépitude et la mortalité sont universellement présents, où que le regard se pose. L’esprit qui découvre cela et maintient cette connaissance est enrichi de ce que l’on appelle « la connaissance de la décrépitude et de la dissolution » (bhangānupassanā-ñāna). C’est la deuxième étape du développement de la connaissance.
c) La connaissance de la décrépitude et de la dissolution, une fois suffisamment développée, fait émerger la prise de conscience que toute chose est à craindre. Toute existence phénoménale, que ce soit dans le domaine des sens, des formes ou du sans-forme, est perçue comme éminemment effrayante car la décrépitude et la dissolution de tous les phénomènes sont vécues consciemment à chaque instant. Ainsi une appréhension très forte naît dans l’esprit de celui qui a cette perception ; elle devient une peur réelle. Toute chose apparaît aussi potentiellement effrayante qu’un poison, une arme mortelle ou de terribles bandits armés. Les trois sphères de l’existence phénoménale ne sont plus qu’objets de frayeur. Cette conscience de la qualité effrayante de tous les phénomènes (bhayatupatthana-ñāna) est considérée comme la troisième étape.
d) Lorsque la conscience de la nature éminemment effrayante de toute existence phénoménale a été totalement développée, apparaît la conscience que toute chose, de par sa nature, est dangereuse. Nous ne sommes pas en sécurité dans le monde matériel. Il est comme une forêt pleine de bêtes menaçantes et si l’on cherche à s’amuser dans cette forêt, on n’y trouve plus rien d’agréable. Cette conscience du danger (ādīnavanupassana-ñāna) inhérent à toute existence phénoménale est la quatrième étape.
e) Quand toute chose est perçue comme étant dangereuse en tous points, le désenchantement apparaît. Tout ressemble à une maison brûlée dont il ne reste que des cendres et un squelette – absolument sans attrait. Ce désenchantement (nibbidānupassana-ñāna) par rapport à notre relation aux choses conditionnées est la cinquième étape du développement et de la connaissance.
f) Quand un authentique désenchantement s’est installé, s’élève alors le désir de se libérer vraiment des choses. Ce désir est tout à fait différent de notre envie normale de liberté laquelle, dépourvue de la stimulation qu’apporte la force de la concentration ou la vision pénétrante, n’est pas un réel désir de liberté. Le désenchantement qui naît de la vision pénétrante de vipassanā englobe l’esprit tout entier et le désir de liberté est aussi vaste que le désenchantement, et donc tout à fait authentique. Ce désir d’échapper à l’insatisfaction de l’existence phénoménale est aussi grand que le désir de liberté d’une grenouille qui chercherait à échapper à la gueule d’un serpent, ou celui d’un daim ou d’un oiseau qui se débat pour échapper au piège dont il est prisonnier. Ce véritable désir d’échapper à la souffrance (muñcitukamyatā-ñāna) est la sixième étape.
g) A présent, avec le plein développement du désir de s’échapper, apparaît un sentiment de lutte intense pour trouver une issue. Par l’introspection, on perçoit l’attachement et les poisons du mental qui sont la cause de l’emprisonnement de l’esprit, les liens qui l’enserrent dans cette condition. On cherche alors le moyen de diminuer ces pollutions puis, quand on parvient à les diminuer, on cherche à les éliminer complètement.
Cette diminution des pollutions de l’esprit peut être illustrée par une comparaison. Un homme relève son filet de pêche et y trouve un serpent qu’il prend pour un poisson. Si on lui dit que c’est un serpent, il ne le croit pas, du moins pas tant qu’il n’aura pas rencontré un maître bon, sage et compatissant qui le guidera et l’éduquera jusqu’à ce qu’il voie par lui-même qu’il s’agit effectivement d’un serpent. Alors il prend peur et cherche un moyen de tuer le serpent. Il le prend par le cou, le soulève au-dessus de sa tête et le fait tourner jusqu’à ce que, épuisé, le serpent tombe mort. Cette comparaison illustre l’éveil de la prise de conscience que les voiles qui polluent l’esprit sont la cause de l’asservissement des hommes à une condition redoutable.
Sans technique pour diminuer, au jour le jour, l’impact des pollutions qui obscurcissent l’esprit, il sera impossible de les éliminer définitivement. Leur force est beaucoup plus grande que les connaissances encore maigres que nous pouvons déployer contre elles. C’est pourquoi ces connaissances doivent être élargies et la souffrance causée par les pollutions de l’esprit diminuera simultanément. Garder toujours présent à l’esprit le fait que tout est impermanent, sans valeur intrinsèque et dépourvu de soi, que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu, permet de cesser d’alimenter tout ce qui obscurcit l’esprit, d’affaiblir ces pollutions mentales de jour en jour. Il nous appartient de nous développer, de nous renforcer, de nous rendre toujours plus fins et plus ingénieux. Aussi petits que nous soyons, nous pourrons ainsi dépasser des obstacles grands comme des montagnes. Nous sommes comme une petite souris qui aurait à tuer plusieurs tigres. Nous devons être extrêmement déterminés et sans cesse prêts à trouver des moyens adaptés à notre taille. Si nous ne pouvons arriver à rien directement, nous devons utiliser toutes sortes de méthodes et de techniques pour affaiblir ces tigres, jour après jour, plutôt qu’essayer de les tuer d’emblée. Cette recherche intense de moyens d’échappatoire (patisankhānupassana-ñāna) constitue la septième étape de la connaissance et de la vision du progrès sur la Voie.
h) L’affaiblissement des pollutions de l’esprit permet de nous rendre de plus en plus indépendants et détachés des choses. Ainsi, l’étape suivante dans le développement de la compréhension juste qui résulte dans l’absence d’attirance pour les choses, consiste à voir tous les phénomènes comme étant vides, dépourvus d’essence, dépourvus de statut – animaux, personnes, etc. – dépourvus de substance ou de permanence, dépourvus de valeur car profondément insatisfaisants, et dépourvus de tout attrait car profondément décevants. Progressivement, l’esprit devient indépendant et imperméable à tout, dans n’importe quel domaine d’existence. Les choses qui étaient auparavant agréables, désirables et attachantes sont perçues comme des blocs de pierre et de terre.
Ceci a été également expliqué au moyen d’une comparaison. Un homme qui a toujours aimé sa femme peut un jour changer et cesser de l’aimer si, par exemple, elle a été infidèle. Une fois divorcé, il est libre d’agir à sa guise et son esprit n’a plus de raison d’être perturbé. A ce niveau de connaissance, des situations qui paraissaient jusqu’alors attrayantes à leur manière, sont perçues comme dénuées de substance, de sorte que l’on peut s’en libérer et y être imperturbable en toutes circonstances – tout comme l’homme devient indépendant après son divorce. Ce détachement par rapport à tous les phénomènes (sankhārupekkhā-ñāna) est la huitième étape.
i) L’esprit qui se retrouve ainsi indépendant et détaché de toute existence phénoménale est prêt à perfectionner la Voie et à connaître les Quatre Nobles Vérités (saccanulomika-ñāna). A ce stade, on est entièrement disposé à dépasser les pollutions de l’esprit, à briser les chaînes qui asservissent au monde et à devenir un ariyan à un degré ou un autre. C’est la neuvième étape du processus de la connaissance et de la vision du progrès le long de la Voie.
Lorsque toutes les étapes de ce développement de la connaissance ont été franchies, depuis la connaissance du début et de la fin de toute chose jusqu’à l’état de réceptivité aux Quatre Nobles Vérités, le méditant a atteint le quatrième niveau de vipassanā ou sixième Purification. La connaissance pure et parfaite qui en découle est un instrument qui révèle au chercheur le chemin qu’il a parcouru, et qui peut continuer à le mener à la vision intuitive parfaite qui anéantit toutes les pollutions de l’esprit.
(VII. 5)
La vision intuitive parfaite, ou pureté de la connaissance et de la vision, septième purification, est la vision pénétrante qui naît de la Voie perfectionnée. Elle est le but, le fruit de la pratique de vipassanā. Cette vision pénétrante qui naît de la Voie perfectionnée est la cinquième et dernière étape de vipassanā.
Entre l’état de réceptivité à percevoir les Nobles Vérités et cette vision intuitive parfaite, il y a la connaissance « probatoire » (gotrabhū-ñāna) qui marque le point de transition entre l’individu ordinaire, dont l’esprit est obscurci par des pollutions, et l’ariyan. Mais cette connaissance probatoire ne dure qu’un instant. Elle est le point culminant de la perfection progressive de la connaissance et se situe encore au niveau du bon karma, au niveau du royaume des sens.
Pour nous résumer, vipassanā est une observation pénétrante qui s’appuie sur la vertu et la concentration. Qu’observons-nous ? Absolument tout. Nous observons le monde, l’existence phénoménale, les objets conditionnés ou les cinq agrégats – puisque toute existence phénoménale n’est autre que le jeu des cinq agrégats. Et que cherchons-nous à voir ? Nous cherchons à voir l’impermanence, l’insatisfaction et l’impersonnalité inhérentes à toutes les choses de ce monde. Nous les voyons naître, vivre et disparaître jusqu’à les percevoir comme absolument terrifiantes et décevantes, et réaliser que rien ne vaut la peine d’être obtenu ou vécu. Telles sont les situations qui doivent naître de la pratique de vipassanā. Quel est le but de vipassanā ? Le but immédiat est de diminuer l’ignorance, le mot vipassanā signifiant « claire vision ». Quel est le fruit de vipassanā ? C’est l’apparition d’une vision intuitive, d’une vision claire et durable de la nature des choses, laquelle aboutira à éliminer progressivement toutes les pollutions de l’esprit. Une fois celles-ci disparues, il ne reste que la perfection, l’Eveil, la paix. Rien ne lie plus l’esprit aux conditions du monde et, en conséquence, on échappe au monde et à l’esclavage des sens. L’esprit est libéré de la souffrance parce qu’il est libéré à jamais de toute convoitise et de tout désir. Le Bouddha a appelé cet état : l’obtention du fruit de la Voie, le Nirvana. Atteindre cela, c’est avoir mené jusqu’au bout la tâche que le bouddhisme nous a assignée.
Telle est la voie de la vision pénétrante que nous devons parcourir. Elle compte sept niveaux de purification qui incluent les neuf étapes du processus de développement de la connaissance du monde. Ensemble ils constituent vipassanā. Dans les Ecritures, vipassanā est présenté comme un système structuré, tandis que les points de détail se trouvent dans les écrits ultérieurs des maîtres de méditation. Cependant il y a quelque chose d’important qu’il faut bien saisir pour éviter tout malentendu. Il se trouve que, même dans la pratique du Dhamma, aspect le plus élevé du bouddhisme, il existe des déviations. A l’heure actuelle, nombreux sont ceux qui prétendent enseigner, sous le nom de vipassanā, quelque chose qui n’a rien en commun avec la réalité. Ils en font leur gagne-pain, créent des groupes de pratique et attirent les gens en leur accordant le grade d’« éveillé » (ariya puggala) à la mode moderne. Tout ceci est extrêmement méprisable et regrettable.
Chapitre IX
ÉMANCIPATION DU MONDE
La méditation vipassanā est un entraînement de l’esprit dont le but est d’élever l’esprit à un niveau tel qu’il ne soit plus sujet à la souffrance. L’esprit se libère de la souffrance grâce à la connaissance claire que rien ne vaut la peine d’être convoité ; ainsi les choses du monde cessent de nous entraîner dans de nouveaux attachements et de nouveaux rejets. L’esprit qui maîtrise cette connaissance transcende la condition humaine et atteint le niveau que l’on appelle « le plan supra-mondain » (lokuttara-bhūmi).
Pour bien comprendre ce qu’est le plan supra-mondain, il nous faut d’abord connaître son contraire, le plan mondain (lokiya-bhūmi). Le plan mondain se situe à tous les niveaux où les choses du monde contrôlent l’esprit. Très brièvement on peut dire qu’il y a trois niveaux sur le plan mondain : le niveau des sens (kāmāvacara-bhūmi), lorsque l’esprit se satisfait des plaisirs de toutes sortes ; le niveau des formes (rūpavacara-bhūmi), condition de l’esprit qui se désintéresse des objets des sens mais qui trouve sa satisfaction dans les différents stades de la concentration sur les formes en tant qu’objets ; et enfin, le niveau du sans-forme (arūpavacara-bhūmi), niveau le plus élevé de l’esprit qui trouve sa satisfaction dans les délices et la paix de la concentration sur des objets autres que des formes. A ces trois niveaux du plan mental, on trouve la plupart des êtres. Qu’il s’agisse d’êtres humains ou célestes, de dieux, d’animaux ou d’habitants de l’enfer, ils sont tous inclus dans ces trois niveaux mondains. L’esprit d’un être peut habiter alternativement l’un de ces trois niveaux à tout moment ; il n’y a là rien d’exceptionnel, c’est tout à fait normal. Cependant, de manière générale, on aura tendance à retomber naturellement au niveau des sens sans concentration, l’esprit humain étant normalement sous l’influence des délices que représentent les couleurs et les formes, les sons, les odeurs, les saveurs et les contacts physiques. Ce n’est qu’à certaines occasions qu’il peut échapper à ces attraits et faire l’expérience de la tranquillité et de la félicité qui naissent de la pratique de la concentration sur les formes ou sur le sans-forme – tout dépend de sa concentration.
A certains moments, donc, l’esprit d’une personne peut se situer à n’importe lequel de ces niveaux de concentration. En Inde, à l’époque du Bouddha, ceci devait être assez fréquent car il y avait, dans tout le pays, des hommes vivant dans les forêts qui étaient à la recherche de la paix et du bonheur que l’on associe aux différents niveaux de concentration. De nos jours, de tels hommes se font rares, mais il est néanmoins possible à l’homme ordinaire d’atteindre ces niveaux. Si quelqu’un dans ce monde fait l’expérience de la joie suprême de la concentration sur une forme, alors « le monde », pour lui, se réduit à cette forme car il n’est conscient de rien d’autre. A cet instant et pour cette personne, « le monde » n’est que cela et restera cela jusqu’à ce que la condition de son esprit évolue.
Même si une personne vivant à l’un de ces trois niveaux a atteint un tel calme et une telle tranquillité qu’il en vient à rester parfaitement immobile comme un roc ou une souche, la convoitise et l’attachement au soi sont toujours présents. Il existe également encore en lui toutes sortes de désirs, même des plus subtils – comme la déception, lors de la disparition de l’état dans lequel il se trouve, déception qui le pousse à rechercher un nouvel état. Ce désir de changement constitue le karma, et cette personne n’a donc pas encore transcendé l’état mondain. Elle n’a pas atteint le plan supra-mondain.
Un esprit qui se situe sur le plan supra-mondain a transcendé le monde. Il considère l’état mondain comme dénué d’essence, de soi, de substance, et s’en détourne. Les individus qui vivent dans cette sphère se situent à l’un des quatre niveaux de la Voie et de ses fruits : il y a le niveau de Celui qui pénètre dans le courant (sotāpanna), de Celui qui ne reviendra qu’une fois (sakadāgāmī), de Celui qui ne reviendra plus (anāgāmī) et le niveau du Parfait ou Arahant. La condition de ces quatre types de nobles êtres ou ariyans est dite « supra-mondaine ». « Supra-mondaine » signifie « au-dessus du monde », et se réfère à l’esprit et non au corps. Le corps peut se trouver n’importe où, pourvu que les conditions de vie soient adéquates. Le mot « supra-mondain » décrit simplement un esprit qui réside au-dessus du monde. Quant aux mondes d’en-dessous – tels que l’enfer, le purgatoire ou les lieux de souffrance, de tourment et d’esclavage –, ils n’existent tout simplement pas pour les ariyans.
Les critères qui permettent de reconnaître les quatre niveaux du plan supra-mondain sont les différents poisons du mental qui sont en cours d’élimination. Le Bouddha a divisé les poisons de ce groupe selon dix catégories et les a appelées « les entraves » (samyojana). Ces dix entraves retiennent l’homme et tous les êtres du monde en les maintenant sur le plan mondain. Si l’on commence à desserrer ces liens et à s’en libérer, l’esprit se libère progressivement, graduellement, de sa condition mondaine. Quand on réussit à s’en libérer complètement, on transcende réellement le monde et on vient demeurer en permanence sur le plan supra-mondain.
La première de ces pollutions mentales subtiles qui nous lie est la croyance en un soi (sakkāya-ditthi) : penser que le corps et l’esprit sont « moi ». Il s’agit là d’une erreur, d’un malentendu basé sur l’attachement à l’idée de « je suis ». Du fait que l’individu moyen n’est, en général, pas conscient de la véritable nature du corps et de l’esprit, il les considère, sans réfléchir, comme étant « lui ». Il lui semble évident que le corps et l’esprit constituent un « moi », un « je ». Cette idée instinctive est si fermement enracinée que personne ne la remet jamais en question. Il est vrai que l’instinct de préservation est ce qui permet à la vie de se maintenir, de rechercher la nourriture et de multiplier l’espèce. Mais ce que nous appelons ici « croyance en un soi » doit être compris, dans son sens le plus primaire, comme la cause essentielle de l’égoïsme. C’est la première des entraves, celle qui doit disparaître avant toute autre chose.
La deuxième entrave est le doute (vicikicchā), cause de l’hésitation et de l’incertitude. Avant tout, il s’agit là du doute concernant la pratique qui mène à la libération de la souffrance ; ce doute naît d’une connaissance insuffisante de l’efficacité de cette pratique : est-ce vraiment ce qui me convient ? En suis-je capable ? N’y a-t-il pas de meilleure façon d’y parvenir ? Est-ce vraiment efficace ? Le Bouddha a-t-il réellement atteint l’Eveil ? S’est-il vraiment libéré de la souffrance ? Ses enseignements et la méthode qu’il propose libèrent-ils réellement de la souffrance ? Est-il vraiment possible à un moine du Sangha d’atteindre la libération de la souffrance ?
La racine du doute est l’ignorance. Si l’on raconte à un poisson qui a toujours vécu dans l’eau ce qui se passe sur la terre sèche, il n’en croirait pas un mot ou du moins pas grand-chose. Quant à nous, immergés dans un univers de sensualité, nous y vivons comme le poisson dans l’eau, de sorte que si l’on nous parle de transcender la sensualité et le monde, nous n’y comprenons rien. Et ce que nous pourrions comprendre dans une certaine mesure, nous en doutons. Il nous est naturel de penser ainsi. Penser à un niveau élevé fait apparaître une nouvelle image : c’est le conflit entre le niveau de pensée plus élevé et le niveau de pensée ordinaire qui provoque l’hésitation et le doute. Si l’énergie de l’esprit est insuffisante, c’est le bas niveau de pensée qui triomphera. Le doute et l’hésitation relatifs au bien sont présents en chacun de nous, de manière récurrente, depuis notre naissance. Chez une personne dont l’éducation a été déficiente, cela peut être une maladie très ordinaire. Il nous faut observer, par l’introspection, combien les conséquences de ces hésitations sont négatives, qu’elles sont constamment présentes dans notre travail et notre vie quotidienne, au point que nous en venons à douter du bien, de la vérité et de la libération de la souffrance.
La troisième entrave est la superstition (sīlabbataparāmāsa) ou attachement aux règles et aux rites basé sur une mauvaise compréhension de leur raison d’être originelle. Il s’agit essentiellement d’un attachement erroné à certaines choses que l’on fait, et qui a généralement trait à des doctrines et des cérémonies. Un exemple évident de superstition, que l’on retrouve même parmi les bouddhistes, est la croyance en la magie et les pratiques magiques. Méditer dans l’espoir d'en retirer des pouvoirs magiques et psychiques ou des forces protectrices est totalement erroné et irrationnel. Un autre exemple consiste à prendre les préceptes – dont le but réel est de développer une conduite vertueuse pour éliminer les pollutions qui obscurcissent l’esprit – en croyant que cela donnera naissance à des pouvoirs miraculeux qui nous permettront d’éradiquer ces pollutions. Dans ce cas, nous ne faisons que nous attacher à des objets, nous les approprier, et nous finissons par obtenir exactement l’inverse de ce que nous recherchions. La pratique est parfaite en elle-même mais, si nous ne la comprenons pas et que nous nous y attachons de manière irrationnelle, comme si elle était magique ou sacrée, elle devient de la pure superstition. De même, si on prend les préceptes dans l’espoir, par exemple, de renaître sous la forme d’un être angélique, c’est sans aucun doute une forme d’attachement aux règles et aux rituels, et cela va à l’encontre des enseignements du bouddhisme. De telles croyances polluent une conduite qui pourrait être vertueuse en tout point. Le but de la discipline du bouddhisme est d’éliminer les pollutions les plus grossières du corps et de la parole pour préparer les fondations du développement progressif de la concentration et de la vision pénétrante – ce n’est pas de renaître au paradis ! Avoir une motivation aussi fausse, c’est souiller et contaminer sa propre moralité par l’attachement et la convoitise, par de faux concepts. Si on pratique la charité, les préceptes moraux ou la méditation avec une fausse idée de leur objectif réel, on s’éloigne inévitablement de la Voie que nous a montrée le Bouddha.
Prenez donc conscience que les pratiques bouddhiques elles-mêmes peuvent devenir superstition lorsqu’elles sont associées à une mauvaise compréhension et à l’espoir d’obtenir des pouvoirs mystiques. C’est également vrai de toutes ces petites choses que la plupart d’entre nous a plaisir à pratiquer, comme les chants rituels, les actions méritoires et ainsi de suite. Si la cérémonie qui consiste à placer du riz et des plateaux de sucreries devant l’image du Bouddha est pratiquée en croyant qu’il s’agit d’une offrande à « l’esprit » du Bouddha et qu’il pourra en bénéficier, il est à cent pour cent certain que les effets produits seront diamétralement opposés à ceux espérés. Cette conduite, qui va à l’encontre de son objectif réel, est très répandue dans les milieux bouddhistes mais elle est totalement irrationnelle. C’est ainsi que des pratiques qui étaient, à l’origine, belles et bonnes, sont contaminées par l’ignorance de ceux qui les appliquent. Voilà ce qu’est la superstition. Comme nous l’avons vu, cette pollution a pour origine l’ignorance et la mauvaise compréhension des choses. Nous avons pratiquement tous des croyances personnelles sur les pouvoirs mystiques, du fait d’une mauvaise information ou d’un conditionnement erroné. Inutile d’entrer davantage dans le détail à ce stade mais, bien que cela dérange, chacun devrait faire son autocritique sur la question, en fonction de ce qui vient d’être dit.
Lorsque quelqu’un a complètement abandonné ces trois premiers obstacles – croyance en un « moi », doute, et superstition – on dit qu’il a atteint le premier niveau du plan supra-mondain, c’est-à-dire qu’il est devenu « Celui qui entre dans le courant ». Abandonner définitivement ces trois entraves ou « poisons de l’esprit » n’est pas difficile du tout, car ce ne sont que les attributs primitifs de gens primitifs et peu évolués. Quiconque a correctement étudié et progressé devrait être débarrassé de ces trois obstacles et être capable de devenir un ariyan ; sinon, c’est que la personne est encore ignorante et dans l’illusion ou, pour employer un meilleur terme, c’est un être du monde (puthujjana), un être dont l’œil intérieur est couvert d’un épais bandeau.
Lorsqu’un individu a réussi à abandonner ces pollutions, son esprit est libéré des entraves du monde. Il est libéré de l’ignorance et de l’illusion qui faisaient de l’ombre à la vérité et qui rattachaient l’esprit au monde. Les abandonner, c’est comme laisser derrière soi trois entraves ou trois bandeaux sur les yeux, s’en libérer et s’élever au-dessus du monde et au-delà, vers le premier niveau du plan supra-mondain. Voilà ce que signifie devenir un ariyan du premier niveau, atteindre le premier niveau du plan supra-mondain. On dit d’une telle personne qu’elle est « entrée dans le courant », qu’elle a atteint, pour la première fois, le fleuve qui coule vers le Nirvana. Cela signifie qu’après avoir atteint ce stade, la personne est sûre d’arriver au Nirvana, un jour ou l’autre, dans l’avenir. Elle n’a atteint que le fleuve du Nirvana, pas le Nirvana lui-même, mais ce fleuve est un courant qui coule directement vers le Nirvana, qui descend vers lui, exactement comme le cours d’eau d’une rivière descend vers la mer. Bien qu’il lui faille encore du temps, un esprit qui a enfin pénétré « le courant » est certain d’arriver un jour au Nirvana.
Atteindre le second niveau du plan supra-mondain signifie abandonner les trois entraves dont nous venons de parler mais aussi être capable d’atténuer certaines formes d’attachement, d’aversion et d’ignorance, au point que l’esprit s’élève et ne soit plus que très légèrement attaché à la sensualité. La tradition veut qu’un tel individu ne revienne plus qu’une seule fois dans ce monde, c’est pourquoi on l’appelle « Celui qui reviendra une fois ». Cette personne est plus proche du Nirvana que « Celui qui entre dans le courant » car il ne reste en lui qu’une infime trace d’attachement au monde. S’il devait revenir au monde sensoriel des êtres humains, ce ne serait qu’une seule fois parce que l’attachement, l’aversion et l’ignorance, bien qu’encore présents, ont été extrêmement atténués.
Au troisième stade, nous trouvons « Celui qui ne reviendra pas ». Ce niveau d’ariyan, outre une certaine libération des pollutions de l’esprit permettant d’être « Celui qui reviendra une fois », a également réussi à abandonner les quatrième et cinquième entraves. La quatrième entrave est le désir des sens, et la cinquième est la négativité. Ni Celui qui entre dans le courant ni Celui qui reviendra une fois n’a complètement abandonné le désir sensuel : il reste en eux une trace de satisfaction face aux objets attirants et désirables ; même s’ils ne croient plus en un soi et ont éliminé le doute et la superstition, ils ne sont pas encore capables de renoncer complètement à leur attachement aux attraits des sens ; il en reste des traces. Par contre, un ariyan du troisième niveau, celui qui ne reviendra pas, a réussi à abandonner cela complètement ; il n’en reste aucune trace. Quant aux poisons de la négativité, qui inclut tous les sentiments de colère ou de rancœur, il a déjà été largement lavé au stade de Celui qui reviendra une fois, de sorte qu’il n’en reste qu’une trace qui obstrue l’esprit ; Celui qui ne reviendra pas s’en débarrasse totalement. Il a donc rejeté tant le désir sensuel que la négativité.
Le désir sensuel ou attachement aux plaisirs des sens a été expliqué au chapitre quatre. C’est un obscurcissement chronique, fermement ancré dans l’esprit, comme s’il en faisait partie intégrante. Il est difficile, à l’homme ordinaire, de le comprendre et de l’éliminer. Tout, absolument tout, peut être objet de désir ; les couleurs, les formes, les sons, les odeurs, les saveurs, les objets tactiles de toutes sortes sont les objets des sens (kāma), et l’état d’attachement de l’esprit, qui apparaît sous forme de satisfaction, est le désir sensuel (kāma-rāga).
Ce que nous appelons négativité est la réaction d’un esprit qui ressent une insatisfaction. (Lorsqu’il y a satisfaction, c’est le désir sensuel ; lorsqu’il y a insatisfaction, c’est la négativité. L’esprit de la plupart des humains est sujet à ces deux états.) Nous pouvons même éprouver de la négativité face à des objets inanimés et, plus grave encore, être mécontents de ce que nous avons nous-mêmes créé, des choses qui sont nées de notre esprit. Quand on ressent de la haine et de la colère, la négativité est allée trop loin. Un ariyan, de niveau inférieur à « Celui qui ne reviendra pas », l’a déjà abandonnée jusqu’à un point correspondant à son état. La négativité qui demeure à effacer pour un ariyan du troisième niveau n’est plus qu’une réaction de l’esprit si subtile qu’il n’en paraît parfois rien au dehors. C’est une perturbation interne que nulle expression du visage ne trahit mais qui est ressentie à l’intérieur comme de l’insatisfaction, de l’irritation ou de l’agacement vis-à-vis d’une personne ou d’un objet qui ne répond pas à son attente. Imaginez une telle personne, totalement dénuée de négativité ; voyez quel être exceptionnel ce pourrait être, et combien digne de respect.
Les cinq « entraves » dont nous venons de parler ont été regroupées par le Bouddha comme étant les premières à abandonner : la croyance en un moi, le doute, la superstition, le désir sensuel et la négativité ont tous été éliminés par un ariyan du troisième niveau. Du fait qu’il ne demeure aucun désir sensuel, ce niveau d’ariyan ne retourne jamais à un état d’existence sensorielle, d’où son nom de « Celui qui ne reviendra pas ». Il n’existe plus pour lui qu’un seul mouvement en avant vers l’état d’Arahant et le Nirvana, condition suprême qui n’a plus rien à voir avec la sensualité. Quant aux cinq obstacles qui demeurent, seul l’Arahant, le quatrième niveau de l’ariyan, réussit à s’en libérer totalement.
La sixième des entraves est un attachement aux délices associés aux différentes étapes de la concentration sur les formes (rūpa-rāga). Aux trois premiers niveaux, l’ariyan n’est toujours pas capable d’abandonner son attachement au plaisir et à la tranquillité liés à la profonde concentration sur les formes, mais il y parviendra quand il atteindra le dernier niveau, celui d’Arahant. L’état de parfaite concentration a une saveur enivrante que l’on peut décrire comme un avant-goût du Nirvana. Bien que différent du véritable Nirvana, il en a plus ou moins la saveur. Pendant la concentration parfaite, les pollutions restent en sommeil mais elles n’ont pas complètement disparu ; elles réapparaîtront dès que la concentration sera perdue. Mais il est vrai que, tant qu’elles sont en sommeil, l’esprit est vide, clair, libre et connaît la saveur du véritable Nirvana. C’est pourquoi cet état peut également devenir une cause d’attachement.
La septième impureté subtile est l’attachement aux délices associés à la concentration sur des objets autres que les formes (arupa-raga). Elle ressemble à la sixième entrave mais se situe à un niveau plus subtil encore et plus atténué. La concentration sur un objet comme l’espace ou le vide fait naître une tranquillité et une sérénité plus profondes que la concentration sur une forme, de sorte que l’on risque fort de s’attacher à cet état. Le véritable Arahant ne sera jamais fasciné par un état de sensations plaisantes, quel qu’il soit, parce qu’il est immédiatement conscient de l’impermanence, de l’insatisfaction inhérente et de l’absence de soi de tout état de sensation. Il existe des ermites et des mystiques qui pratiquent la concentration dans la forêt et qui ne sont pas conscients du danger caché de ces états de béatitude ; ils se laissent fasciner par eux et s’attachent à leur saveur, tout comme une personne immature s’attache à la saveur des objets des sens. C’est la raison pour laquelle le Bouddha utilise le même mot de « désir » dans les deux cas. Si vous réfléchissez bien à tout cela et que vous arrivez à en comprendre tout le sens, vous serez pleins d’admiration et de respect pour ces êtres que l’on appelle ariyans.
La huitième entrave qui retient l’homme au monde est un sentiment de supériorité ou d’infériorité (māna). C’est l’illusion d’avoir tel ou tel niveau par rapport aux autres. C’est penser : « Je ne suis pas aussi bien que lui / Je suis aussi bien que lui / Je suis meilleur ou plus élevé que lui », c’est-à-dire se sentir inférieur, égal ou supérieur à l’autre. Attention, il ne s’agit pas d’orgueil ou de prétention, mais il est extrêmement difficile de ne pas se comparer ainsi aux autres. Si cette entrave est placée en huitième position, c’est probablement parce qu’elle est très difficile à abandonner. Seul l’ariyan du plus haut niveau peut s’en détacher. Comparer est une certaine forme d’attachement. Tant que l’esprit demeure préoccupé de bien et de mal, la conscience de l’infériorité, de la supériorité ou de l’égalité par rapport aux autres continuera à le perturber. Ce n’est que lorsqu’il aura complètement transcendé le bien et le mal que ces idées disparaîtront d’elles-mêmes. Sinon, l’état de félicité et la tranquillité lui font encore défaut.
La neuvième entrave est l’agitation (uddhacca), c’est-à-dire l’agitation de l’esprit, la distraction, l’absence de paix et de calme. Ce sentiment apparaît lorsqu’il se passe quelque chose d’intéressant. Nous avons tous des désirs chroniques, en particulier le désir d’avoir, d’être, de ne pas avoir, de ne pas être une chose ou une autre. Quand quelque chose nous parvient – par l’œil, l’oreille, le nez, le palais ou le corps – qui correspond à l’une de nos tendances, il est probable qu’il se produira une réaction de l’esprit, pour ou contre, que l’on appelle « intérêt ». Si nous voyons quelque chose de nouveau et d’étrange, inévitablement un certain trouble, une certaine curiosité s’éveilleront, parce qu’il y a encore des choses que nous désirons et des choses que nous craignons, dont nous nous méfions. Chez les personnes ordinaires, l’esprit ne peut pas résister, il ne peut pas s’empêcher de s’intéresser à toutes les choses qui surviennent. Si l’objet en question coïncide avec l’un de nos désirs, il est difficile d’y résister, nous nous y intéresserons probablement au point de nous y engager, nous nous en réjouirons au point de nous oublier en lui. Si c’est un objet indésirable, l’esprit ressentira un certain abattement et son plaisir s’achèvera. Telle est la nature de l’agitation.
Aux trois premiers niveaux, l’ariyan connaît encore la curiosité mais l’Arahant en est totalement dépourvu. Son esprit a aboli tout désir pour quoi que ce soit, toute peur, toute haine, tout souci, anxiété, méfiance et doute, tout désir de connaître et de voir des choses. Son esprit est libre. Rien ne peut le provoquer, l’attirer ou éveiller sa curiosité, du simple fait qu’il a éliminé la partialité. Il faut remarquer que l’existence ou la naissance de l’agitation, dans toute situation, est la conséquence d’une certaine forme de désir, y compris le désir de connaissance. Quand on s’est libéré du désir en réalisant l’impermanence, l’inanité et la non personnalité de toute chose, rien ne paraît plus valoir la peine d’être obtenu, c’est pourquoi il n’y a plus de curiosité pour rien. Si la foudre venait à tomber aux pieds d’un Arahant, il l’ignorerait parce qu’il n’a ni peur de la mort, ni désir de vivre, ni quoi que ce soit. Même si quelque chose de dangereux arrivait ou qu’une grande découverte était faite dans le monde, il n’en éprouverait aucune curiosité parce que ces choses n’ont aucun sens pour lui. Il ne s’intéresse pas à ce qu’elles pourraient avoir à lui offrir parce qu’il n’y a rien qui le tente ou qui éveille sa curiosité. Son esprit connaît une pureté et une tranquillité telles que nous, gens ordinaires, n’avons jamais connues.
La dixième et dernière entrave est l’ignorance. Cela recouvre toutes les formes de pollutions dont nous n’avons pas encore parlé. Le mot « ignorance » se rapporte à une absence de connaissance et, dans ce cas, « connaissance » signifie « réel savoir, connaissance juste ». Evidemment aucune créature ne peut exister sans une certaine connaissance, mais si celle-ci est fausse, elle ne vaut guère mieux qu’une non-connaissance. La plupart des gens souffrent d’ignorance chronique ou de fausse connaissance ; nous sommes presque tous plongés dans les ténèbres de l’ignorance. Les questions les plus importantes pour l’être humain sont celles qui se posent ainsi : « Qu’est-ce que la souffrance ? Quelle est la véritable cause de l’apparition de la souffrance ? Quelle est la véritable libération de la souffrance ? Et quel est le véritable moyen d’atteindre la libération de la souffrance ? » Celui qui a la connaissance vraie est libre de l’ignorance, il est éveillé. L’ensemble des connaissances de l’humanité est infini mais le Bouddha a décrété que, pour la plupart, elles ne sont pas essentielles. L’Eveil du Bouddha n’incluait que ce qu’il est nécessaire de savoir. Le Bouddha savait tout ce qu’il est nécessaire de savoir. Le mot « omniscient » signifie connaître ce qui est nécessaire, et n’inclut rien de ce qui n’est pas essentiel.
Du fait de l’ignorance, les gens prennent la souffrance pour du plaisir, au point de nager en rond dans une mer de souffrances. Ils se trompent de même quand ils accusent les esprits, les êtres célestes ou autres, d’être la cause de leurs souffrances et de leurs malheurs, au lieu de rectifier la situation par les moyens appropriés. Emettre des souhaits en direction de ces esprits et de ces êtres célestes est une manifestation du plus bas degré d’ignorance. Eliminer totalement la souffrance ne peut se faire qu’en supprimant la soif du désir qui en est la cause directe. Croire que l’état bienheureux de tranquillité ou d’inconscience qui naît de la concentration est synonyme de complète extinction de la souffrance est faux. Cette idée était courante à l’époque du Bouddha et perdure encore aujourd’hui. Certaines écoles de pensée en sont même venues à considérer la sensualité comme un instrument d’élimination de la souffrance, de sorte que des sectes aux pratiques honteuses et obscènes sont nées dans les temples même. Ces gens-là croient fermement que la sensualité est un élément essentiel de la vie, une sorte de nourriture vitale. Non contents des quatre nécessités que sont la nourriture, les vêtements, l’abri et les médicaments, ils en rajoutent une : la sensualité.
Celui qui ne connaît pas la Voie qui mène à l’extinction de la souffrance risque fort d’agir de façon erronée, motivé par ses seuls désirs, s’appuyant naïvement sur des choses matérielles ou sur des esprits et des êtres célestes. Un tel individu, même bouddhiste de naissance, peut aller aussi loin dans l’erreur simplement à cause du pouvoir de l’ignorance qui l’empêche de se satisfaire du Noble Octuple Sentier pour éliminer la souffrance. Il préfère allumer de l’encens et des cierges en faisant des souhaits adressés à des êtres soi-disant surnaturels.
Tout un chacun désire acquérir des connaissances mais, si la « connaissance » acquise est fausse, plus on en sait plus on se trompe et trop de connaissances finissent par aveugler. Nous devons faire attention au mot « illumination ». La « lumière » en question risque d’être une lueur d’ignorance qui aveugle, trompe l’œil et donne une excessive confiance en soi. Aveuglés par l’éclat de l’ignorance, nous ne pouvons plus réfléchir correctement et ne sommes donc pas en mesure de mettre la souffrance en déroute. Nous perdons notre temps en trivialités, en actions non essentielles, indignes de notre respect. Nous nous délectons de sensualité, comme si c’était une bonne chose, essentielle aux êtres humains, comme si nous devions tous en profiter avant de mourir, et prétextons que nous agissons ainsi en vertu d’un idéal différent. L’espoir de renaître au paradis est basé sur la sensualité. Tout attachement, particulièrement à la sensualité, naît de l’ignorance qui encombre notre esprit et lui bloque toute issue. Dans les Ecritures, l’ignorance est souvent comparée à une grosse coquille qui recouvre le monde et empêche les êtres de voir la lumière.
Le Bouddha a placé l’ignorance en dernier sur la liste des dix entraves. Quand une personne devient un Arahant, le niveau le plus élevé d’ariyan, il élimine complètement les cinq dernières entraves ou poisons mentaux. Il élimine le désir des formes, le désir des objets autres que les formes, la comparaison aux autres, l’agitation et l’ignorance. Les quatre types d’ariyan – Celui qui entre dans le courant, Celui qui reviendra une fois, Celui qui ne reviendra pas et l’Arahant – se situent sur le plan supra-mondain. On reconnaît, à ce plan, neufs aspects. L’état de celui qui entre dans le courant tandis qu’il procède à l’élimination des pollutions s’appelle « la Voie de l’entrée dans le courant » et, quand il a réussi à éradiquer les pollutions, c’est « l’état du fruit de l’entrée dans le courant ». De même on trouve, allant de pair, la Voie et le fruit de Celui qui reviendra une fois, la Voie et le fruit de Celui qui ne reviendra pas, et la Voie et le fruit de l’état d’Arahant. Ces quatre paires ajoutées au Nirvana constituent les neufs aspects du plan supra-mondain. Un individu qui se situe sur ce plan voit le degré de sa souffrance diminuer, en fonction de son niveau, jusqu’à en être totalement libéré. Lorsqu’il réussit à percevoir, dans une clarté parfaite, la véritable nature des choses au point de cesser de désirer quoi que ce soit, il atteint le plan supra-mondain : son esprit a transcendé la condition de ce monde. Ensuite, quand il aura complètement et absolument abandonné toutes les pollutions mentales, son esprit sera libéré définitivement de toutes ces choses du monde qu’il aimait ou détestait autrefois.
Le Nirvana est un état qui ne peut se comparer à rien, différent de toutes les conditions humaines. Il est, en fait, la négation même de la condition humaine. Si l’on prend toutes les caractéristiques de la condition humaine, de l’existence phénoménale, et qu’on les efface complètement, on obtient le Nirvana. Autrement dit, le Nirvana est ce qui est en tous points précisément à l’opposé de la condition humaine.
Le Nirvana ne crée ni n’est créé, étant lui-même la cessation de toute création. En termes de bienfaits, le Nirvana est la libération totale du feu de l’enfer, de l’oppression, de la torture, de l’esclavage, de l’assujettissement, car atteindre le Nirvana sous-entend une complète élimination des poisons mentaux qui sont la cause de tous les états de souffrance de l’esprit.
Le Nirvana se situe au-delà des limitations de l’espace et du temps. Il est unique, ne ressemble à rien de ce qui existe dans ce monde ; c’est l’extinction de la condition humaine. En métaphore, le Bouddha l’a appelé « le monde où cesse tout ce qui est provisoire » (sankhārā-samatho). C’est donc un état de liberté, de liberté par rapport aux entraves. C’est comme la fin des tourments et des batailles, des blessures et des irritations, d’où qu’elles proviennent. Telle est la nature du supra-mondain, l’ultime : c’est le but et la destination des bouddhistes, le fruit final de leur pratique.
CONCLUSION
Dans ces pages, nous avons expliqué méthodiquement, les principes du bouddhisme. Nous l’avons présenté comme une technique pratique et structurée dont le but est d’apporter la connaissance de la véritable nature des choses. En vérité, les choses sont impermanentes, insatisfaisantes et non personnelles, mais toutes les créatures sont attirées par elles et s’y attachent du fait de leur mauvaise compréhension. La pratique bouddhique, basée sur la vertu (sīla), la concentration (samadhi) et la sagesse (paññā) est un outil qui permet d’éradiquer complètement la convoitise et l’attachement. Les objets de notre attachement sont les cinq agrégats : le corps, les sensations, les perceptions, la pensée active et la conscience sensorielle. Lorsque nous percevons la véritable nature de ces cinq agrégats, nous comprenons si bien les choses que notre désir pour elles se transforme en désenchantement, et nous nous détachons progressivement de tout.
Ce qu’il nous faut faire, c’est vivre selon les principes de la vie juste (samma vihāreyyum) et, jour et nuit, être remplis de cette joie qui naît d’un comportement toujours plein de bonté, de beauté et de droiture. Ceci permet de limiter les méandres infinis de la pensée, de se concentrer, et d’avoir, à tout moment, une vision pénétrante des choses. Ensuite, si les conditions sont favorables, arrive le désenchantement, la lutte pour se détacher des choses de ce monde, s’en libérer, ou même atteindre le Nirvana. Si nous voulons aller plus vite et obtenir des résultats rapides, il existe la voie de la pratique appelée vipassanā, qui commence par la pureté morale, la pureté de l’esprit et continue jusqu’à la vision pénétrante intuitive parfaitement claire. Ainsi nous pouvons couper définitivement les entraves qui nous attachent si solidement à ce monde, et atteindre le fruit ultime de la Voie.
Il s’agit là d’un bref résumé de l’ensemble du Bouddha-Dhamma, du début à la fin. Il inclut des principes théoriques et pratiques et couvre tous les sujets, depuis les premiers pas sur la Voie jusqu’au fruit ultime. L’histoire s’arrête au Nirvana. Comme l’a dit le Bouddha : « Tous les Bouddhas ont reconnu le Nirvana comme le bien le plus élevé ». Il nous revient donc de mettre cela en pratique pour réaliser et atteindre ce qui doit être réalisé et atteint. Ainsi nous mériterons d’être appelés bouddhistes, nous développerons la vision pénétrante et découvrirons l’essence véritable du Bouddha-Dhamma. Si nous ne pratiquons pas le Bouddha-Dhamma, nous contentant de savoir qu’il existe, nous n’aurons aucun discernement véritable. Il revient à chacun de nous de pratiquer l’introspection, d’observer et de comprendre nos propres imperfections, puis d’essayer de les éradiquer complètement. Même si nous n’obtenons qu’un demi succès, il en résultera une compréhension claire car, au fur et à mesure que les pollutions sont éliminées, apparaissent, à leur place, la pureté, la vision pénétrante et la paix.
C’est pourquoi je vous recommande d’aborder le Bouddha-Dhamma comme il vous est présenté ici. Cela vous permettra peut-être de « pénétrer dans son courant ». Ne gaspillez pas la chance que vous avez eue de vous incarner en tant qu’être humain et de connaître les enseignements du Bouddha. Ne laissez pas passer cette chance de devenir un être humain parfait.
GLOSSAIRE
Mots en français
Canon pali : collection des Ecritures du bouddhisme Théravada en langue palie. Il se divise en trois « corbeilles » ou Tipitaka.
Caractéristiques (les Trois) : anicca, dukkha et anattā :
L’impermanence des phénomènes, l’insatisfaction ou la souffrance qui en découle, et le non-soi ou absence d’un soi personnel.
Fruit de la Voie : le résultat obtenu en avançant sur l’Octuple Sentier.
Pollutions de l’esprit : kilesa en pāli. Il s’agit d’états mentaux qui obscurcissent temporairement l’esprit et se manifestent sous formes d’actions, de paroles ou de pensées négatives, malveillantes ou malsaines.
Sentier (le Noble Octuple) : la Voie en huit parties proposée par le Bouddha pour atteindre la sagesse et la libération de tous les obstacles ou pollutions de l’esprit.
Voie : Synonyme de l’Octuple Sentier.
Mots en pali
ādīnavanupassana-ñāna : conscience du danger inhérent à toute existence phénoménale.
akusala : malsain, malavisé.
anāgāmī : Celui qui ne reviendra plus.
anattā : non-soi.
anicca : impermanence.
Arahant : Celui qui a atteint le niveau parfait d’accomplissement.
ariya puggala / ariyan : noble être humain qui a atteint l’un des quatre niveaux d’Eveil.
attavādūpādāna : croyance en un soi personnel.
bhangānupassanā-ñāna : connaissance de la décrépitude et de la dissolution.
bhayatupatthana-ñāna : conscience de la qualité effrayante de tous les phénomènes.
brahmacariya : vie monastique de célibat.
citta-visuddhi : la purification de l’esprit.
ditthi-visuddhi : la purification des idées.
ditthūpādāna : l’attachement aux opinions.
dukkha : insatisfaction ou souffrance.
gantha-dhura : l’étude.
gotrabhū-ñāna : la connaissance « probatoire » qui marque le point de transition entre l’individu ordinaire impur et l’ariyan.
kāma : les objets des sens et l’état d’attachement de l’esprit qui apparaît sous forme de satisfaction.
kāma-rāga : le désir sensuel.
kāmūpādāna : l’attachement aux objets des sens.
kankhā-vitarana-visuddhi : la fin du doute.
karanīya : condition de l’esprit apte à travailler sainement.
kusala : ce qui est bon et bien pour avancer sur la Voie.
lokiya-bhūmi : le plan mondain. Il se situe à tous les niveaux où les choses du monde contrôlent l’esprit. Il y a trois niveaux sur le plan mondain : le niveau des sens (kāmāvacara-bhūmi) – lorsque l’esprit se satisfait des plaisirs de toutes sortes ; le niveau des formes, rūpavacara-bhūmi, condition de l’esprit qui trouve sa satisfaction dans les différents stades de la concentration sur les formes ; et enfin, le niveau du sans-forme, arūpavacara-bhūmi, qui trouve sa satisfaction dans les délices et la paix de la concentration sur des objets autres que des formes.
lokuttara-bhūmi : le plan supra-mondain.
maggā-magga-ñānadassana-visuddhi : la pureté par la connaissance et la vision de ce qu'est la véritable Voie à suivre et ce qui ne l’est pas.
māna : l’orgueil, un sentiment de supériorité ou d’infériorité.
muñcitukamyatā-ñāna : véritable désir d’échapper à l’insatisfaction.
ñānadassana-visuddhi : la pureté de la connaissance qui est la perfection du Noble Sentier.
nibbāna : la libération de toute souffrance.
nibbidā : le désenchantement.
nibbidānupassana-ñāna : désenchantement vis-à-vis des choses conditionnées.
paññā : sagesse, connaissance.
passaddhi : le calme.
patipadā-ñānadassana-visuddhi : la pureté par la connaissance et la vision du progrès le long de la Voie.
patisankhānupassana-ñāna : recherche de moyens d’échappatoire.
pīti pamoda : joie spirituelle.
puthujjana : un être humain « du monde », dont l’œil intérieur est couvert d’un épais bandeau.
rūpa-rāga : la concentration sur les formes.
saccanulomika-ñāna : l’esprit indépendant et détaché de toute existence phénoménale, prêt à avancer sur la Voie.
sakadāgāmī : Celui qui ne reviendra qu’une fois.
sakkāya-ditthi : vision erronée des choses, notamment penser que le corps et l’esprit sont « moi ».
samādhi : état de concentration de l’esprit qui le rend apte à s’ouvrir à la sagesse et à la connaissance de ce qui est.
samma vihāreyyum : la vie juste.
samsāra : le cycle incessant des renaissances dans le monde de l’ignorance.
sankhārā : pensée volontaire, active. Intention, volition. Tous les phénomènes conditionnés de l’existence.
sankhārā-samatho : le monde où cesse tout ce qui est provisoire. Etre libéré des entraves.
sankhārupekkhā-ñāna : détachement par rapport à tous les phénomènes.
Saññā : la perception ou prise de conscience de son environnement.
santi : la paix, la sérénité.
sīla : vertu ou comportement moral sur lequel se base toute la pratique bouddhique.
sīlabbataparāmāsa : attachement aux règles et aux rites basé sur une mauvaise compréhension de leur raison d’être. Superstition.
sīlabbatūpādāna : l’attachement aux rites et rituels.
sīla-visuddhi : pureté morale qui fait naître la joie.
sotāpanna : Celui qui pénètre dans le courant.
Tipitaka : les « trois corbeilles » du Canon pāli incluant les Sutta (discours / enseignements du Bouddha), le Vinaya (règles de conduite des moines) et l’Abhidhamma Pitaka (les commentaires).
udayabbayānupassanā-ñāna : la connaissance du début et de la fin née d’une introspection concentrée claire et maintenue, assez puissante pour provoquer le désenchantement du méditant.
uddhacca : agitation de l’esprit, distraction, absence de paix et de calme.
vedanā : sensation ou sentiment qui naît d’un contact sensoriel.
vicikicchā : doute, cause de l’hésitation et de l’incertitude.
vimutti : la Libération ultime.
viññāna : la conscience sensorielle. Il en existe six aspects : conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale.
vipassanā : la vision pénétrante ; cette vision claire qui apparaît lorsque l’esprit est joyeux et libre de toute pollution.
vipassanā-dhura : l’étude vécue à l’intérieur.
virāga : le détachement.
visuddhi : la purification des pollutions mentales ou des poisons de l’esprit.
yathābhūtañānadassana : la vision pénétrante de la véritable nature des choses.